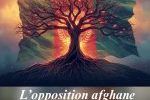Et si ce que l’on a appelé « la guerre entre les Talibans et le Pakistan » n’était ni une guerre, ni une simple mise en scène, mais quelque chose de beaucoup plus déroutant ? Depuis plusieurs semaines, les récits se multiplient, les chiffres s’opposent, les déclarations se contredisent. Impossible de savoir où est la vérité. Ce flou n’est pas un accident : il semble construit, voulu, entretenu. Ce qui se joue à la frontière dépasse la logique d’un affrontement classique. C’est un brouillard stratégique où chaque acteur dit une chose et fait l’inverse, où l’on frappe sans revendiquer, où l’on menace sans agir, où l’on négocie en attaquant. Une guerre en trompe-l’œil, peut-être. Mais surtout, une séquence géopolitique où l’incertitude devient une arme.
Les faits se contredisent dès le départ. Le Pakistan parle de 23 soldats tués et 29 blessés. Les Talibans affirment n’en avoir perdu que neuf et revendiquent la mort de 58 Pakistanais. Islamabad aurait bombardé des positions talibanes à Kaboul et Paktika, mais ne confirme ni ne nie ces frappes. Les Talibans diffusent des vidéos montrant des postes frontaliers capturés : aucune preuve indépendante. Les affrontements sont décrits comme « parmi les plus violents depuis des années » par le New York Times, mais cessent du jour au lendemain après une médiation du Qatar et de l’Arabie saoudite. Tout semble soigneusement calibré : spectaculaire, mais contrôlé.
Une guerre… ou un brouillard stratégique ?
Dawn parle de « conflit ouvert », tout en appelant à ne pas provoquer une escalade. Kaboul reconnaît avoir attaqué des postes pakistanais « en représailles », tout en affirmant suspendre les opérations. Chaque camp se proclame agressé. Chacun accuse l’autre d’avoir franchi la ligne rouge. Dans cette guerre des récits, les faits comptent moins que leur interprétation. Côté taliban, certains analystes voient un affranchissement. Longtemps perçus comme les marionnettes d’Islamabad, les Talibans se rapprochent de l’Inde. Amir Khan Muttaqi est reçu à New Delhi, et l’Inde envisage de rouvrir son ambassade à Kaboul. Ce rapprochement improbable renverse la donne. L’Inde et les Talibans, jadis ennemis, trouvent un intérêt commun : neutraliser le Pakistan. Et pour les Talibans, cette ouverture leur donne une légitimité régionale nouvelle.
Mais d’autres voix, plus sceptiques, doutent de cette lecture romantique. Selon Fahim Kohdamani, ce « conflit » pourrait être une nouvelle étape du jeu d’influence pakistanais. Islamabad chercherait à redorer l’image des Talibans en les présentant comme « défenseurs de la souveraineté afghane ». Ce scénario renforcerait la popularité intérieure d’un régime très affaibli et détournerait l’attention des mouvements séparatistes baloutches et pachtounes. Une manipulation symétrique, où chacun joue son rôle dans un théâtre bien rodé.
Talibans et Pakistan : alliance brisée ou scénario orchestré ?
Cette hypothèse se heurte à une réalité troublante : le Pakistan semble perdre le contrôle. Khawaja Asif reconnaît publiquement que « les Talibans sont notre création, mais ils sont devenus non fiables ». Dans le même temps, il affirme ne pas vouloir la guerre, tout en déclarant que la réponse d’Islamabad « ne sera plus faite d’amour et d’affection ». Et d’ajouter : « Nous savons qui vit en Afghanistan et où. » Le Pakistan se pose en victime tout en revendiquant l’architecture du pouvoir taliban. Il parle pour Kaboul, mais aussi pour Washington, Pékin, Moscou, Riyad. Cette ambiguïté permanente brouille les intentions réelles d’Islamabad.
Les Talibans, de leur côté, jouent une partie complexe. Ils menacent le Pakistan, mais ne peuvent se permettre une guerre totale. Ils se rapprochent de l’Inde, mais gardent des liens avec la Chine. Ils dialoguent avec la Russie via le Format de Moscou. Ils se laissent médiatiser par le Qatar et l’Arabie saoudite. Ils utilisent la carte du nationalisme afghan pour se présenter comme défenseurs de la souveraineté. Mais sur le terrain, ils tolèrent des groupes terroristes comme le TTP, qui frappe directement le Pakistan. Les Talibans ne sont pas un bloc monolithique : ils sont traversés par des factions divergentes, certaines proches d’Islamabad, d’autres totalement hostiles. Ce flou interne renforce la confusion externe.
Quand la région retient son souffle : Inde, Chine, Russie, Golfe, USA
Ce pseudo-conflit ne se joue pas uniquement entre deux États frontaliers. Il s’inscrit dans un Grand Jeu régional qui s’intensifie. Le Qatar et l’Arabie saoudite imposent une trêve en quelques heures, preuve de leur influence directe. L’Iran se propose en médiateur, inquiet de voir la frontière s’enflammer. La Chine, silencieuse, observe avec inquiétude la sécurité de ses routes commerciales et la stabilité du corridor économique Chine-Pakistan (CPEC). La Russie, via le Format de Moscou, teste la possibilité d’intégrer les Talibans dans un nouvel ordre régional anti-occidental. Et les États-Unis, officiellement absents, voient dans ce désordre une opportunité de retour : en soutenant Islamabad contre les Talibans, ou inversement.
Ce n’est peut-être ni une guerre, ni un simple jeu de dupes. C’est une phase charnière où les lignes de loyauté et d’hostilité sont en train de se redessiner. L’Afghanistan n’est plus un satellite docile. Le Pakistan n’est plus le centre de gravité qu’il pense être. La frontière entre le réel et la mise en scène, entre l’affrontement et la communication, devient indiscernable. Les Talibans menacent sans attaquer vraiment. Le Pakistan frappe sans l’assumer pleinement. Les puissances régionales appellent à la désescalade tout en manœuvrant dans l’ombre. Chacun s’abrite derrière un brouillard qu’il contribue à épaissir.
Le double piège mortel qui menace le Pakistan
Car derrière ce flou, une réalité brutale apparaît : le Pakistan est piégé entre deux menaces existentielles. S’il y a bien une chose qu’Islamabad ne peut tolérer, c’est de voir les Talibans se rapprocher de l’Inde, l’ennemi absolu. Ce n’est pas seulement une question d’influence : c’est une question de survie nationale. L’Inde à Kaboul, c’est l’encerclement géopolitique, la fin de la profondeur stratégique pakistanaise, la possibilité d’un front Est-Ouest en cas de guerre. Mais ce n’est pas tout. En parallèle, Khawaja Asif reconnaît que l’Afghanistan est devenu un refuge pour une mosaïque de groupes terroristes : TTP, ISIS-K, Al-Qaïda. Depuis deux ans, le TTP a tué des centaines de soldats pakistanais. Le scénario cauchemar : un Afghanistan allié à l’Inde… tout en laissant le TTP frapper le Pakistan. Entre encerclement extérieur et saignement intérieur, Islamabad se retrouve acculé. Cette combinaison explosive explique peut-être pourquoi le Pakistan alterne menaces, frappes, médiations et contradictions : il ne sait plus s’il doit punir, négocier, contenir ou renverser les Talibans. Et c’est là que la situation devient réellement dangereuse pour toute la région.
Et dans ce jeu à somme nulle, une question demeure : que fera le Pakistan, maintenant qu’il ne contrôle plus les Talibans… et que les Talibans ne craignent plus le Pakistan ?
Déclaration de Nasir Andisha
Nasir Ahmad Andisha est Représentant permanent de l’Afghanistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève depuis avril 2019.

L’Afghanistan et le Pakistan ne sont pas de faux frères jumeaux, mais deux pays voisins, indépendants et partageant des civilisations, des religions, des ethnies et des langues communes, mais avec leurs propres intérêts. Après plus d’un demi-siècle d’hostilité et d’ingérence réciproque, qui ont causé d’immenses souffrances au peuple afghan, entraîné le renversement de cinq gouvernements, le déplacement de dix millions de personnes et le martyre de plus de deux millions de nos compatriotes, et finalement, au troisième siècle du XXIe siècle, conduit la milice la plus endurcie (les talibans) à prendre en main le destin de notre pays, le temps du changement est-il venu ? Le dernier paragraphe de la déclaration du ministère pakistanais des Affaires étrangères, si sa position dans le texte ne reflète pas sa position dans la perspective politique de l’Envoyé, souligne : « Nous (Pakistan) espérons également que le jour viendra où le peuple afghan obtiendra la liberté et vivra sous la domination d’un gouvernement véritablement représentatif et issu de la volonté de son peuple. » Tel est précisément le but de la résistance et de la lutte de notre peuple libre contre le phénomène destructeur de l’extrémisme suicidaire des talibans. Ce changement (soutien à un système démocratique), plutôt qu’à des groupes ethniques et extrémistes, constitue un changement positif. Notre lutte et notre diplomatie sont fondées sur ce principe et cet engagement en faveur des droits humains et de la dignité des hommes et des femmes afghans, et si Dieu le veut, elles seront l’initiatrices et les pionnières de cette transformation historique.
À lire aussi