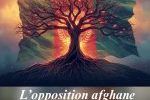La diaspora, dernier espace politique libre
Points clés
- Depuis 2021, le centre de gravité politique s’est déplacé vers l’exil.
- La diaspora détient liberté, capital humain et réseaux diplomatiques.
- Elle agit sur les plans politique, humanitaire, médiatique et juridique.
Implications
- La diaspora devient l’alternative crédible aux talibans.
- Le défi n’est plus l’unité interne mais la reconnaissance externe.
- Besoin d’une stratégie diplomatique et d’une structure coordonnée.
Depuis la chute de la République afghane en août 2021, l’espace politique intérieur a été fermé, la société civile réduite au silence et toute forme d’opposition à la domination talibane étouffée. Pourtant, loin d’être éteinte, la voix afghane s’est déplacée. Elle a quitté Kaboul, Hérat ou Mazar-e-Charif pour renaître à Paris, Londres, Berlin, Toronto, Washington, Doha, Istanbul ou Douchanbé. La diaspora afghane, longtemps perçue comme une communauté dispersée, hétérogène et incapable de s’unir, est devenue l’un des acteurs les plus déterminants de l’avenir du pays. Elle n’est plus seulement une population d’exilés, de réfugiés ou de survivants ; elle est désormais un espace de stratégie, de pensée, de mobilisation et de résistance.
Ce basculement n’est pas uniquement démographique ou émotionnel. Il est structurel. La diaspora détient désormais ce que le pays ne possède plus : la liberté de s’exprimer, la capacité d’agir, les compétences techniques, les réseaux diplomatiques, les ressources économiques et l’accès aux institutions internationales. Elle concentre l’expérience politique de l’ancienne République, l’énergie militante de la société civile, la créativité de la nouvelle génération, la légitimité morale des victimes et la mémoire des luttes passées.
Mais le véritable tournant se produit en 2024–2025. Alors que la communauté internationale continue d’affirmer que “l’opposition afghane est trop divisée pour être un interlocuteur”, un phénomène historique se produit discrètement : les principales forces anti-talibanes en exil commencent à s’unifier autour d’une vision commune. Deux processus majeurs —le Vienna Process et la Cambridge Afghanistan Series IV organisée par la Mosaic Global Foundation regroupant les principaux partis, mouvements et figures de la résistance — aboutissent à une feuille de route politique partagée à plus de 90 %. Pour la première fois depuis 2001, l’opposition afghane produit un projet cohérent de transition post-talibans, incluant État de droit, pluralisme, droits des femmes, justice transitionnelle, unité territoriale, et décentralisation fonctionnelle.
Cette évolution bouleverse la logique classique : la question n’est plus de savoir si les Afghans sont capables de s’unir, mais de savoir si la communauté internationale est prête à reconnaître une alternative politique légitime aux talibans. En d’autres termes, le problème n’est plus intérieur — il est diplomatique.
La diaspora n’est pas seulement un refuge : elle est devenue un centre stratégique. Elle produit du plaidoyer, organise des forums internationaux, soutient les résistances armées, finance les familles restées au pays, accompagne les femmes persécutées, alimente les écoles clandestines, documente les crimes, mobilise les médias et forme la prochaine génération de leaders. Elle fonctionne à la fois comme cerveau, poumon, mémoire et cœur politique de l’Afghanistan.
Ce rapport propose une analyse concentrée de cette nouvelle donne. Il montre comment la diaspora, longtemps fragmentée, est en train de se structurer et de s’affirmer. Comment elle est devenue un acteur diplomatique visible, un soutien logistique à la résistance intérieure, un lieu de renaissance identitaire pour la deuxième génération, un refuge pour l’élite intellectuelle et militaire, et une source vitale de transferts financiers. Mais aussi comment ses faiblesses — rivalités, manque de reconnaissance internationale, pressions géopolitiques — freinent encore sa pleine efficacité.
Il ne s’agit pas ici d’idéalisme : la diaspora ne peut pas, seule, “libérer” l’Afghanistan. Mais elle est aujourd’hui la seule force afghane libre, organisée, compétente et légitime. Dans un pays prisonnier, elle est la seule qui puisse encore penser l’avenir. Dans un monde qui hésite, elle est la seule qui puisse encore négocier. Et dans un moment historique où l’alternative semble avoir disparu, elle est peut-être la seule carte encore sur la table.
La diaspora afghane n’est plus périphérique : elle est le centre de gravité du possible. Et c’est autour d’elle que se redéfinit la question fondamentale : qui représente l’Afghanistan, et quel pays voulons-nous reconstruire ?
1. Une diaspora multiple, mais structurée comme jamais
Diaspora — Mosaïque en voie d’architecture
Forces
- Compétences variées (ONG, universités, médias, sécurité, tech).
- Réseaux transnationaux numériques, coordination rapide.
- Hybridation intergénérationnelle (mémoire + expertise contemporaine).
Limites
- Statuts juridiques inégaux, stratification socioéconomique.
- Clivages ethniques/idéologiques résiduels.
- Besoin d’une plateforme représentative durable.
La diaspora afghane est l’une des plus anciennes et des plus étendues au monde. Elle ne s’est pas formée en une seule vague, mais par strates successives : exil massif pendant l’invasion soviétique en 1979, fuite durant la guerre civile des années 1990, départs liés à la montée des talibans en 1996, migration économique et académique après 2001, puis choc final de 2021, qui a vidé le pays de ses cadres, de ses élites, de ses journalistes, de ses enseignants, de ses artistes, de ses juges et de ses militaires. Chaque vague a apporté avec elle des profils différents, des ambitions différentes, des réseaux différents. Cette hétérogénéité a longtemps été vue comme une faiblesse. Elle est aujourd’hui une force.
La diaspora afghane n’est pas concentrée dans un seul pays comme certaines diasporas nationales. Elle est répartie dans l’ensemble du monde : Pakistan et Iran accueillent toujours plusieurs millions d’Afghans, souvent invisibles mais essentiels dans les flux transfrontaliers, les économies parallèles et les réseaux culturels. L’Europe, notamment l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Scandinavie et le Royaume-Uni, abrite une diaspora plus politisée, souvent diplômée, active dans les ONG, les institutions, les médias. L’Amérique du Nord (États-Unis, Canada) concentre une diaspora hautement qualifiée, intégrée dans les universités, les think tanks, les organisations humanitaires et les technologies. L’Australie est devenue un bastion du militantisme hazara et des mouvements de défense des droits humains. Le Golfe, la Turquie et l’Asie centrale accueillent des communautés en position charnière entre le pays d’origine et les circuits économiques mondiaux.
Cette dispersion géographique n’empêche pas la circulation de l’information, des idées, des fonds et des stratégies. Au contraire : la diaspora fonctionne en réseau. Elle utilise les technologies numériques pour coordonner actions, mobilisations, conférences et plaidoyers. Elle combine l’expérience de la première génération (mémoire de la guerre, de la résistance, de la monarchie ou de la République) et l’expertise des élites post-2001 (diplomatie, développement, gouvernance, droits humains). Elle intègre aussi la deuxième génération, née ou éduquée en exil, qui apporte une maîtrise des langues locales, des codes culturels occidentaux et des espaces médiatiques.
La diversité interne de la diaspora reste réelle : différences ethniques, politiques, religieuses, générationnelles. Mais depuis 2022, une évolution profonde s’opère. L’urgence de la situation en Afghanistan et la reconnaissance du fait que « personne à l’intérieur ne peut parler librement » ont conduit la diaspora à se percevoir non plus comme un groupe de réfugiés, mais comme le dernier espace de souveraineté nationale. Ce changement de posture a accéléré la structuration de plateformes transnationales : think tanks afghans en exil (AISS, AFTF), réseaux de femmes, associations de jeunes, conseils consultatifs, groupes d’experts, coalitions politiques.
Ainsi, paradoxalement, alors que le pays est fragmenté, la diaspora commence à s’unifier. Longtemps accusée d’être divisée, elle construit peu à peu une architecture de coordination. Cette évolution atteint un point décisif en 2024–2025, avec deux événements majeurs qui changent la donne : la conférence de Cambridge (Mosaic Foundation) et le Vienna Process.
2. Le tournant 2024–2025 : une feuille de route commune à 90 %
Unification politique — Cambridge & Vienne
Consensus (≈90 %)
- Fin du régime taliban et transition inclusive.
- État de droit, pluralisme, libertés publiques.
- Justice transitionnelle ; unité nationale + décentralisation fonctionnelle.
- Droits des femmes et des minorités non négociables.
Ce que cela change
- Le narratif « opposition divisée » devient caduc.
- Base crédible pour l’engagement des bailleurs et États.
- Socle commun pour une plateforme représentative de la diaspora.
Pendant des années, la communauté internationale a justifié son inaction par un argument simple : « Nous ne pouvons pas soutenir l’opposition afghane, car elle est divisée. » Ce discours s’est effondré en 2024–2025. L’opposition en exil n’est plus fragmentée comme autrefois. Elle a commencé à converger, non pas sur des slogans, mais sur une architecture politique détaillée de l’après-talibans.
Le Vienna Process, lancé en 2023 et consolidé lors de la 5e conférence (février 2025), a rassemblé entre 80 et 100 délégués représentant l’ensemble du spectre anti-taliban : anciens responsables gouvernementaux, leaders de partis politiques, résistants armés, représentants de minorités, organisations de femmes, intellectuels, experts en droit, membres de la diaspora éduquée. Ce processus, hébergé en Europe, a permis d’établir un socle politique commun : reconstitution d’un État légitime, transition inclusive, justice équitable, participation de toutes les communautés, protection des droits fondamentaux. À Vienne, des groupes de travail ont produit des documents structurants : modèle de transition, principes constitutionnels, cadre électoral, rôle de l’armée, mécanismes de sécurité, réintégration des exilés. Les participants ont affirmé avoir atteint un accord sur environ 80 à 90 % des points de la future feuille de route.
Parallèlement, la Cambridge Afghanistan Series IV (septembre 2025), organisée par la Mosaic Global Foundation, a réuni des représentants de la résistance armée (NRF, AFF, ALM), des acteurs politiques, de la société civile, de la diaspora jeune, des experts indépendants. L’objectif n’était pas seulement de discuter, mais de fusionner les différentes propositions politiques existantes en un « Composite National Roadmap ». Cette roadmap est une synthèse opérationnelle de plus d’une douzaine de documents produits par divers groupes en exil. Elle réaffirme des principes communs :
- Fin du régime taliban et refus de toute normalisation
- Transition encadrée par un mécanisme national soutenu internationalement
- État de droit et séparation des pouvoirs
- Pluralisme politique et libertés publiques
- Droits des femmes non négociables
- Unité nationale sans partition ethnique
- Décentralisation fonctionnelle
- Justice transitionnelle et responsabilisation
Ce qui est remarquable, c’est que la résistance militaire, la société civile, les anciens responsables étatiques, les jeunes, les femmes et les experts technocratiques sont parvenus à un alignement massif. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une vision politique nationale, crédible et partagée, existe. Ce consensus, largement ignoré par les chancelleries occidentales, bouleverse la donne.
Le vieux narratif ancré dans les capitales étrangères — « il n’existe pas d’alternative aux talibans » — est faux. Une alternative existe, elle est structurée, elle est prête, elle est presque unifiée. L’obstacle est désormais externe : la reconnaissance internationale et le soutien politique.
3. La diaspora, pilier de la résistance politique, civile et militaire
Diaspora & Résistance — Leviers d’action
Apports
- Diplomatie parallèle (parlements, ONU, think tanks).
- Narratif international et maintien de l’attention médiatique.
- Logistique et renseignement pour les résistances intérieures.
- Mobilisations transnationales (tribunaux populaires, campagnes).
Défis
- Absence de soutien étatique durable.
- Pressions géopolitiques et normalisation rampante.
- Coordination encore imparfaite exil–terrain.
- Risque d’instrumentalisation par des acteurs extérieurs.
La résistance au régime taliban n’est pas seulement armée. Elle est politique, médiatique, sociale, juridique, culturelle. Et sur tous ces terrains, la diaspora joue un rôle central.
Sur le plan politico-médiatique, la diaspora est la voix de l’Afghanistan libre. Elle organise des conférences, publie des tribunes, participe à des auditions parlementaires, produit des rapports, alerte les institutions internationales, mobilise les médias, façonne le récit narratif. Sans la diaspora, la cause afghane aurait déjà disparu de l’attention mondiale. La diaspora est le dernier megaphone du pays.
Sur le plan diplomatique, la diaspora mène la diplomatie parallèle. Elle rencontre des parlementaires européens, intervient dans des forums de l’ONU, participe à des négociations informelles, engage des discussions avec l’Inde, l’UE, les États-Unis, le Canada, l’Australie. Elle construit des alliances, propose des feuilles de route, signale les risques de reconnaissance des talibans, alerte sur les violations du droit international. La diaspora empêche que le régime taliban soit normalisé.
Sur le plan civile et juridique, la diaspora est le catalyseur de grandes mobilisations. L’exemple le plus emblématique est le Tribunal populaire pour les femmes d’Afghanistan (Madrid, octobre 2025). Plus de 100 organisations de la diaspora et de la société civile ont coordonné un processus quasi judiciaire international documentant les crimes du régime taliban, notamment l’apartheid de genre. Ce tribunal symbolique a donné la parole aux victimes, produit des preuves, appelé à des actions juridiques internationales et demandé des poursuites. Ce niveau d’organisation montre la capacité de la diaspora à générer des événements globaux de haute portée politique.
Sur le plan militaire et sécuritaire, les anciens officiers de l’armée nationale afghane, aujourd’hui en exil, sont souvent les architectes stratégiques des opérations de guérilla. Sans la diaspora, les résistances comme la NRF, l’AFF ou d’autres groupes locaux seraient isolées et étouffées.
Mais la diaspora ne se contente pas de soutenir : elle veut structurer. Elle cherche à transformer la résistance en projet politique, en alternative gouvernementale. La résistance militaire seule ne peut gagner. La diaspora seule ne peut pas rentrer au pays. Ensemble, elles peuvent former un gouvernement en exil, une autorité de transition, une plateforme crédible. Cette convergence commence à se produire.
Les obstacles restent réels : manque de soutien international, pressions du Pakistan, neutralité de l’Iran ou de la Russie, concurrence entre mouvements, peur de l’Occident de « déstabiliser » les talibans. Mais une réalité s’impose : sans la diaspora, la résistance mourrait en silence. Avec elle, elle devient visible, légitime et potentiellement soutenable.
4. Deuxième génération et élite en exil : le futur leadership
Deuxième génération & élite — Leadership émergent
Atouts
- Bilinguisme, maîtrise des codes institutionnels et médiatiques.
- Femmes leaders : plaidoyer normatif puissant et constant.
- Élite technocratique post-2021 : « État cognitif » en exil.
Points de vigilance
- Risque de déconnexion avec le terrain afghan.
- Besoin de formation politico-diplomatique structurée.
- Inclusion systématique des jeunes et des femmes dans la gouvernance.
La diaspora afghane n’est pas seulement faite d’exilés de première génération. Une nouvelle génération, née ou élevée à l’étranger, émerge avec une identité hybride, une éducation internationale et une capacité à naviguer entre cultures. Cette deuxième génération joue un rôle croissant dans la transformation de la diaspora en acteur stratégique.
Ces jeunes Afghans maîtrisent les langues des pays d’accueil, comprennent les codes institutionnels, sont à l’aise dans les médias, occupent des positions dans les universités, les ONG, les entreprises. Ils sont journalistes, juristes, médecins, artistes, chercheurs, entrepreneurs. Contrairement aux stéréotypes, beaucoup d’entre eux ne se détachent pas de leur identité afghane, mais la réinventent. Ils revendiquent un Afghanistan moderne, pluraliste, égalitaire. Ils refusent la nostalgie des anciennes élites, mais aussi la barbarie talibane. Ils veulent un nouveau contrat social.
Les femmes de la diaspora occupent une place centrale. Elles sont souvent les voix les plus puissantes contre le régime taliban : militantes, avocates, journalistes, chercheuses, porte-parole de la résistance féminine. Elles articulent une vision politique qui intègre égalité de genre, droits humains, éducation et modernité. Leur leadership est de plus en plus reconnu au niveau international.
Parallèlement à cette jeunesse engagée, l’exode post-2021 a produit une diaspora d’élite composée d’anciens cadres de l’État afghan : juges de la Cour suprême, ministres, diplomates, hauts fonctionnaires, professeurs d’université, chercheurs, ingénieurs, officiers militaires, experts du renseignement. Ces individus possèdent une connaissance intime des institutions, des relations internationales, des mécanismes de gouvernance. Ils sont accueillis dans des universités, des think tanks, des organisations internationales. Ils enseignent, écrivent, interviennent dans des conférences. Ils sont les dépositaires du savoir-faire institutionnel de l’ancienne République.
En combinant l’énergie de la deuxième génération et la compétence de ces élites, la diaspora devient ce que certains appellent un « État cognitif en exil » : elle n’a pas de territoire, mais elle a les idées, les valeurs, les compétences, les diplomates, les cadres, les juristes, les militaires et les leaders nécessaires pour reconstruire un jour un État. Elle n’a pas d’armée, mais elle a les anciens commandants. Elle n’a pas de capitale, mais elle a des hubs stratégiques (Paris, Londres, Washington, Berlin, Toronto, Doha). Elle n’a pas de constitution, mais elle a une feuille de route politique commune.
Le futur leadership de l’Afghanistan est probablement déjà dans la diaspora. La question est : quand et comment pourra-t-il revenir ?
5. La diaspora comme poumon économique et juridique de l’Afghanistan
Poumon économique & juridique — Filet vital
Ce qui fonctionne
- Remittances massives : amortisseur social pour des millions de familles.
- Réseaux hawala : rapidité, capillarité, contournement des blocages.
- Soutien juridique et évacuations ciblées (journalistes, femmes, juges).
- ONG diasporiques : efficacité, proximité, réactivité.
Risques & contraintes
- Taxation/contrôle des flux par les talibans.
- Sanctions et “de-risking” bancaire freinant les canaux formels.
- Criminalisation possible de certains transferts.
- Besoin de transparence pour la confiance des bailleurs.
Si la diaspora disparaissait demain, l’Afghanistan s’effondrerait immédiatement. Les transferts de fonds envoyés par les Afghans à l’étranger représentent entre 15 % et 20 % du PIB national. Dans certaines régions, ils constituent la principale source de revenus des ménages. Les remittances (l’argent qu’un migrant envoie depuis le pays où il vit/travaille vers sa famille restée dans son pays d’origine) financent nourriture, soins, éducation, logement. Sans elles, des millions de familles basculeraient dans la famine.
Mais l’impact de la diaspora ne se limite pas aux transferts officiels. Elle utilise aussi des réseaux informels comme la hawala, qui permettent de contourner les sanctions internationales, les restrictions bancaires et le contrôle taliban. La diaspora finance des écoles clandestines pour filles, des cliniques, des programmes d’alphabétisation, des actions humanitaires ciblées. Les ONG diasporiques sont souvent plus rapides, plus efficaces et plus proches du terrain que les grandes organisations internationales.
La diaspora joue aussi un rôle crucial dans la protection juridique et humaine. Elle aide les femmes menacées à fuir, soutient les demandes d’asile, mobilise des avocats, accompagne les journalistes, documente les disparitions, alerte les organisations de droits humains. Elle construit des réseaux de solidarité transnationale capables de sauver des vies. Dans de nombreux cas, sans la diaspora, les activistes, juges, journalistes ou militaires afghans auraient été arrêtés, torturés ou exécutés.
Mais ce soutien économique et juridique fait l’objet d’une guerre silencieuse. Les talibans cherchent à taxer les transferts, à contrôler la hawala, à confisquer l’aide, à espionner les réseaux. Les sanctions internationales rendent les transferts officiels presque impossibles, forçant la diaspora à utiliser des canaux parallèles risqués. Les pays d’accueil durcissent leurs législations, rendant plus difficiles les évacuations et les regroupements familiaux. La diaspora se bat donc sur deux fronts : aider le pays sans renforcer le régime.
Malgré ces obstacles, elle reste le poumon vital de l’Afghanistan. Elle alimente le pays en ressources financières, en soutien moral, en expertise, en information, en protection. Elle compense l’effondrement de l’État. Elle maintient en vie ce qui reste de société civile. Elle est, littéralement, la ligne de survie du pays.
6. Vers une diaspora stratégique : conditions pour peser réellement
Vers une diaspora stratégique — Conditions de réussite
Chantiers prioritaires
- Plateforme représentative permanente, inclusive et crédible.
- Stratégie diplomatique unifiée (ONU, UE, G7, Inde, monde musulman).
- Alliance opérationnelle avec la résistance intérieure (rôles clairs).
- Gouvernance intégrant jeunes/femmes + mécanismes de transparence.
Effets attendus
- Crédibilisation de l’alternative post-talibans.
- Capacité de négociation accrue avec bailleurs et États.
- Récit commun stabilisé + feuille de route opérationnelle.
- Mobilisation coordonnée des ressources humaines & financières.
La diaspora afghane a le potentiel d’être un acteur décisif de l’après-talibans. Elle possède les ressources humaines, les réseaux internationaux, la légitimité morale, la capacité de lobbying, la mémoire historique et la vision politique. Elle a même, depuis 2024–2025, une feuille de route politique consensuelle. Alors, que manque-t-il ?
Trois conditions essentielles.
1. Une structure représentative.
Il manque un organe permanent capable d’incarner la diaspora d’une manière inclusive, crédible et organisée. Pas un “gouvernement en exil” symbolique, mais une plateforme reconnue, ouverte, intégrant résistance armée, société civile, technocrates, jeunes, femmes, experts. Le Vienna Process et la Cambridge Conference pourraient servir de fondation à cette structure.
2. Une stratégie diplomatique concertée.
La diaspora doit parler d’une seule voix auprès des acteurs clés : ONU, Union européenne, États-Unis, Inde, G7, monde musulman. Elle doit proposer une feuille de route claire pour la transition, avec des étapes concrètes, des garanties, des mécanismes. Elle doit convaincre que l’alternative existe et qu’elle est plus stable à long terme que le statu quo taliban.
3. Une alliance avec la résistance intérieure.
La diaspora ne peut pas rester abstraite ou déconnectée du terrain. Elle doit coordonner ses efforts avec les résistances locales (politiques, civiles, armées) et construire un front commun. Cela suppose de dépasser les rivalités entre leaders, de répartir les rôles (militaire / diplomatique / narratif / humanitaire) et de mutualiser les ressources.
Si ces conditions sont réunies, la diaspora peut devenir un acteur de transition légitime. Elle pourrait négocier avec la communauté internationale, organiser des consultations nationales, préparer une constitution, établir un gouvernement intérimaire, gérer les ressources, coordonner la reconstruction. Elle a la capacité, les compétences, les contacts et désormais la vision politique.
Le monde attend souvent qu’une opposition soit unifiée avant de la soutenir. La diaspora afghane a fait ce travail. Elle a fait ce que les puissances étrangères n’attendaient pas d’elle : elle s’est prise en main. Elle n’a pas encore un État, mais elle a une proposition d’État. Elle n’a pas encore le pouvoir, mais elle a un projet. Et ce projet est, fait historique, partagé à plus de 90 % par les principales forces en exil.
Conclusion – La diaspora est prête. Le monde, non.
La diaspora est prête ; le blocage est externe
À retenir
- Unification politique (Vienne + Cambridge) : socle commun robuste.
- Rôle vital : diplomatie, finances, protection, récit.
- Leadership : deuxième génération + élite technocratique.
Prochain pas
- Reconnaissance d’une plateforme représentative.
- Feuille de route assortie de jalons vérifiables.
- Canaux financiers sécurisés pour l’aide et la reconstruction.
La dispersion forcée du peuple afghan aurait pu signifier la fin de son histoire politique. Au contraire, elle a déplacé le centre de gravité national à l’extérieur du pays. La diaspora est devenue le dernier espace où l’Afghanistan existe comme nation consciente d’elle-même. À l’intérieur, le pays est pris en otage. À l’extérieur, il pense, agit, parle, résiste.
Entre 2021 et 2023, la diaspora a survécu.
Entre 2023 et 2024, elle s’est organisée.
En 2024–2025, elle s’est unifiée.
Aujourd’hui, elle a :
- une vision politique commune,
- une feuille de route de transition,
- des réseaux diplomatiques,
- des élites intellectuelles et militaires,
- une nouvelle génération prête à diriger,
- une capacité de mobilisation internationale,
- une légitimité morale incontestable.
La diaspora n’est plus un groupe d’exilés.
Elle est la seule alternative stratégique crédible aux talibans.
Le véritable obstacle n’est plus l’unité afghane.
Le véritable obstacle est l’hésitation internationale.
Tant que les puissances étrangères préféreront un statu quo “stable” sous les talibans à une transition démocratique portée par la diaspora, rien ne changera. Mais cette position est à courte vue : les talibans ne stabilisent pas l’Afghanistan, ils le vident de sa population, détruisent son économie, répriment sa société, exportent l’extrémisme et préparent la prochaine crise régionale.
La diaspora, elle, propose un avenir.
Elle n’est pas parfaite. Elle doit encore se structurer davantage, inclure toutes ses composantes, construire une représentation légitime. Mais elle a fait l’essentiel : elle a prouvé que l’Afghanistan n’est pas condamné à la tyrannie. Elle a démontré qu’un autre projet national est possible, réalisable, prêt.
Si le monde cherche un interlocuteur pour l’Afghanistan de demain, il existe déjà.
Il vit à Paris, à Londres, à Toronto, à Berlin, à Kaboul en secret, dans les montagnes du Panjshir, dans les universités américaines, dans les tribunaux populaires de Madrid, dans les conférences de Vienne, dans les feuilles de route de Cambridge.
Il s’appelle diaspora.
Il est prêt.
Il ne manque plus qu’une chose : que le monde l’écoute.
Diaspora afghane depuis 2021 — Documents clés & thèses
Rapports & données
UNHCR – Operational Data Portal: Afghanistan Situation — tableaux de bord, notes de situation, retours depuis Iran & Pakistan (mises à jour régulières).
UNHCR – Afghanistan (country page) — tableaux de suivi hebdomadaires des retours, documents et cartes.
UNHCR – Global Trends 2023 (juin 2024, PDF) — tendances mondiales, volumes afghans et comparaisons régionales.
Mixed Migration Centre – Changing Dynamics of Afghan Migration after Aug 2021 — routes, profils, risques post-2021. PDF
IOM – The Afghan Diaspora: Partners in the Crisis Response — cartographie d’organisations de diaspora et priorités d’action (Italie, transnational).
IOM Afghanistan – Crisis Response — cadres opérationnels et mises à jour humanitaires.
Contexte UE / asile
EUAA – COI Report: Afghanistan Country Focus (nov. 2024, PDF) — gouvernance talibane, sécurité, profils à risque.
EUAA – Latest Asylum Trends — tendances mensuelles, place des demandeurs afghans dans l’UE+.
EUAA – Latest Asylum Trends: Mid-Year Review 2025 (PDF) — revue semestrielle 2025.
ECRE – Policy Note #45: Afghan Asylum Applicants in the EU (mars 2024, PDF) — pratiques & obstacles pour les Afghans en Europe.
Remittances & soutiens transnationaux
World Bank/KNOMAD – Migration & Development Brief 40 (juin 2024, PDF) — tendances globales des transferts (références Afghanistan).
Sayed & Marchand (2024) – Afghan diaspora remittances — chapitre (Open Access) sur le rôle des envois de fonds afghans.
ANU – Diaspora Humanitarians: Afghanistan Briefing (oct. 2024, PDF) — mobilisation de la diaspora (Australie) et enseignements.
Articles académiques récents
Safi & Czaika (2024/2025) – The transnational engagement of Afghan diaspora organizations — fsQCA sur 85 ADOs en Europe (Global Networks).
Mixed Migration Centre (2025) – Protection and assistance for Afghans in mixed migration — conditions de protection et assistance depuis 2021.
ICMPD (2024) – Displaced Afghans in Central Asia (Policy Brief, PDF) — trajectoires, voies légales, limites régionales.
Thèses & travaux (France/UE)
Hashemi Hamidi, A.H. (depuis 2023) – Diaspora afghane en France et activités transnationales (INALCO) — projet de thèse (sociologie/anthropologie).
INALCO (11 avril 2025) – Demi-journée d’étude “Diaspora afghane & transnationalisme” — programme et intervenants (références utiles pour contacts/entretiens).
Mises à jour opérationnelles
UNHCR – Afghan Returns Emergency Update #11 (26 sept. 2025) — effet des expulsions et restrictions opérationnelles.
À lire aussi