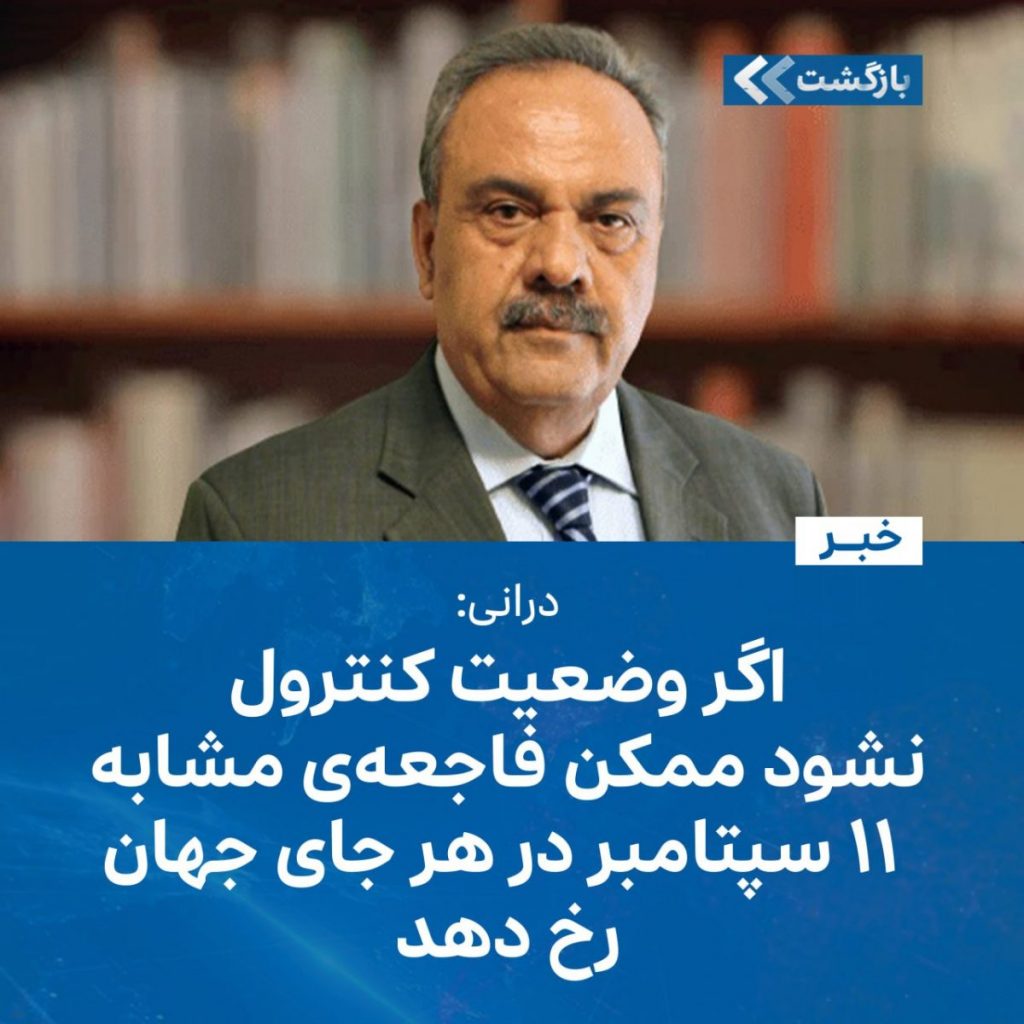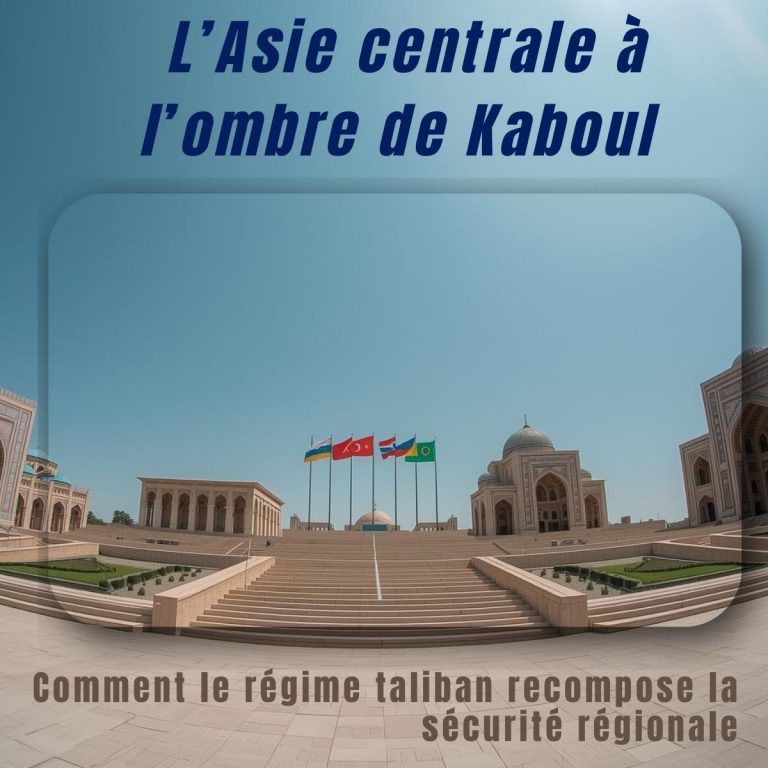Terroristes, mais partenaires ? Le glissement dangereux du réalisme stratégique
Le dernier rapport du Crisis Group, publié le 16 juillet 2025, soulève une question aussi inquiétante que centrale : jusqu’où les démocraties sont-elles prêtes à aller, au nom de la lutte contre l’État islamique, dans la collaboration avec des régimes qu’elles ont elles-mêmes autrefois qualifiés de terroristes, criminels ou despotiques ? Intitulé “The Islamic State in Afghanistan: A Jihadist Threat in Retreat?”, ce rapport recommande ouvertement de renforcer la coopération sécuritaire entre les pays occidentaux, la Russie de Vladimir Poutine, le régime syrien de Bachar el-Assad, et… les Talibans afghans.
Ce qui n’était encore récemment qu’un secret de polichinelle – l’échange discret de renseignements entre services – devient ici une proposition politique assumée : faire des Talibans et de Damas des partenaires de sécurité internationaux légitimes, au nom de la lutte contre la menace transnationale que représente la branche afghane de l’État islamique (IS-KP).
On ne saurait trop insister sur la gravité d’une telle bascule, à la fois morale, politique et géopolitique. Car ce qui est ici présenté comme une démarche pragmatique s’apparente en réalité à une légitimation rampante de régimes criminels, au détriment des principes fondateurs de nos démocraties.
La dangereuse doctrine du “moindre mal”
Le rapport du Crisis Group dresse un état des lieux très documenté du repli stratégique de l’État islamique-Khorasan (IS-KP), confronté à une répression intense des Talibans depuis 2021, au moins sur le papier et il est permis d’en douter fortement. Faute de pouvoir s’imposer militairement sur le sol afghan, l’organisation a multiplié les attaques au Pakistan, en Iran, en Russie, et tenté des incursions en Europe. Son modus operandi : des cellules transnationales, souvent pilotées par des commandants d’Asie centrale, et un recrutement via les diasporas ou les réseaux sociaux.
Face à cette menace, les auteurs du rapport en tirent une conclusion troublante : il faudrait “faire davantage en matière de collaboration avec les Talibans et le gouvernement syrien”, et “renforcer la coordination, y compris entre les Talibans, la Russie et les gouvernements occidentaux” pour empêcher de nouvelles attaques.
Cette formulation aseptisée dissimule mal une réalité brutale : la Russie mène une guerre d’agression en Ukraine, bombarde des civils et utilise le chantage énergétique comme arme de guerre ; quant aux Talibans, ils imposent un apartheid de genre, emprisonnent ou tuent leurs opposants, protègent les commanditaires du 11-Septembre, et poursuivent l’épuration ethnique dans les vallées du Panjshir.
Ce sont donc ces trois régimes, aux antipodes des valeurs démocratiques, que le rapport propose de considérer comme des partenaires contre le terrorisme. Cette logique du “moindre mal”, si elle s’impose, annonce une ère de compromissions dangereuses.
Des terroristes d’hier devenus interlocuteurs aujourd’hui ?
La contradiction est criante. Les Talibans restent étroitement liés à Al-Qaïda, accueillent les réseaux financiers djihadistes, et bénéficient du soutien tacite de certains États du Golfe. La Russie, elle, instrumentalise depuis des années le jihadisme pour diviser ses voisins ou justifier ses interventions militaires, en Tchétchénie comme en Syrie. Quant à la Syrie, son président Ahmed al-Charaa également connu par son nom de guerre d’Abou Mohammed al-Joulani, est un ancien commandant djihadiste affilié à Al Qaida pendant de nombreuses années.
Faire de ces régimes des “boucliers” contre l’EI-K revient à confier les clés du poulailler au renard. Car non seulement ils ont nourri ou abrité les djihadistes qu’ils prétendent aujourd’hui combattre, mais ils en ont fait, à plusieurs reprises, un instrument de leur propre politique extérieure ou intérieure.
Une idée qui fait son chemin dans les couloirs européens ?
Le Crisis Group, basé à Bruxelles, n’est pas un organe officiel de l’Union européenne. Mais ses rapports sont lus, diffusés et parfois repris dans les cercles diplomatiques, les comités d’experts ou les commissions parlementaires. Sous couvert de neutralité analytique, l’organisation défend souvent une forme de “realpolitik humanitaire” qui tend à accepter les régimes en place, aussi violents soient-ils, dès lors qu’ils assurent une stabilité relative.
Ce glissement s’inscrit dans un mouvement plus large de banalisation du dialogue avec les Talibans, au sein même de certaines institutions européennes. Le Parlement européen a heureusement jusqu’ici résisté aux appels à une reconnaissance officielle, mais des programmes humanitaires sont déjà mis en œuvre en coordination avec des ministères talibans. Et certains États membres, comme la Hongrie ou l’Italie, flirtent avec l’idée d’une “ouverture” diplomatique, au nom du contrôle migratoire ou de la stabilité régionale.
Dans ce contexte, le rapport du Crisis Group pourrait servir de base pseudo-technique pour justifier demain des alliances contre-nature. Il est donc impératif de nommer et dénoncer ce qui est en train de se produire : le démantèlement discret du front démocratique contre les régimes terroristes ou criminels.
Pour une sécurité fidèle aux valeurs démocratiques
Aucune démocratie ne peut se permettre de combattre une menace terroriste en pactisant avec ceux qui en partagent l’idéologie, la brutalité ou les méthodes. Le chantage sécuritaire exercé par certains États autoritaires ne doit pas nous faire perdre de vue que la sécurité ne peut être durable que si elle est adossée aux droits humains, à la justice, et à la vérité.
Cela implique de renforcer la coordination internationale sans sacrifier la conditionnalité politique, de soutenir les forces démocratiques afghanes, syriennes ou russes en exil, et de créer un front commun pour isoler les régimes qui protègent ou instrumentalisent les groupes extrémistes, même s’ils prétendent aujourd’hui les combattre.
Les attentats de l’EI-K sont une menace réelle. Mais la solution ne peut passer par la soumission à ceux qui ont semé les graines de son expansion.
Ce rapport, aussi exhaustif soit-il, met surtout en lumière la menace persistante de l’EI-KP et l’ambiguïté du prétendu combat mené par les Talibans. De nombreux analystes soulignent en effet que l’EI-KP et les Talibans ne sont que les deux faces d’une même médaille.