Un séisme meurtrier dans l’est de l’Afghanistan : le rapport de la Banque mondiale révèle l’ampleur d’une tragédie silencieuse
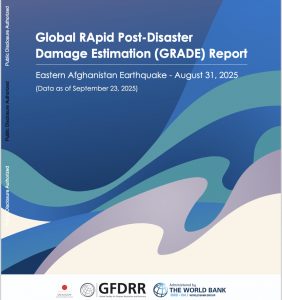
Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) – Eastern Afghanistan Earthquake, August 31, 2025
ChatGPT a dit :
Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) – Eastern Afghanistan Earthquake, August 31, 2025
Le 31 août 2025, à 23 h 47, l’Afghanistan s’est à nouveau effondré, littéralement. Un séisme de magnitude 6,0 a frappé les provinces orientales de Kunarha, Nangarhar, Laghman et Noristan, provoquant l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières depuis un quart de siècle. Dans un pays déjà ravagé par la guerre, l’isolement, l’effondrement économique et la répression, la terre elle-même a ajouté son poids à la tragédie. Selon le rapport Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) publié par la Banque mondiale et le Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), le bilan est accablant : près de 2 000 morts, plus de 3 600 blessés et jusqu’à 1,3 million de personnes affectées. Les dégâts matériels sont estimés à 183 millions de dollars, soit plus de 1 % du PIB afghan. C’est un désastre humanitaire, économique et social d’une ampleur considérable — un tremblement de terre au sens propre comme au figuré pour une nation déjà à genoux.
Un pays fracturé par la terre et par l’histoire
Les provinces de l’est, montagnes abruptes et vallées encaissées, sont parmi les plus pauvres et les plus isolées du pays. Le séisme a frappé la nuit, dans des villages construits en pierre et en terre, sans fondations solides ni normes parasismiques. En quelques secondes, des milliers de maisons se sont effondrées sur leurs habitants endormis. Dans les districts de Nurgal, Chawkay, Dara-e-Nur ou encore Watapur, la quasi-totalité des habitations a été détruite. Les routes coupées par les glissements de terrain ont empêché les secours d’atteindre rapidement les zones sinistrées. Les survivants ont passé des nuits à la belle étoile, sans abri, sans eau potable, dans un silence de mort que seule rompait la rumeur des répliques.
Mais cette tragédie n’est pas un simple accident géologique : elle révèle la fragilité structurelle d’un pays miné par des décennies de guerre, de désintégration institutionnelle et d’abandon international. Le séisme de 2025 s’ajoute à une série noire : Paktika en 2022, Hérat en 2023, et maintenant Kunarha. Chaque fois, les mêmes images de ruines et de corps, les mêmes cris d’impuissance, et la même incapacité à reconstruire durablement.
Une économie à l’arrêt, une population piégée
Le rapport GRADE souligne que les pertes économiques équivalent à plus d’un pour cent du PIB national, dans un pays dont la production économique annuelle plafonne à 17 milliards de dollars. Les zones touchées, essentiellement rurales, vivent de l’agriculture de subsistance et de l’élevage. Or 97 % des stocks de nourriture et des abris pour le bétail ont été détruits dans certaines régions, tandis que plus de 75 000 animaux ont péri. Ces pertes frappent le cœur des moyens de survie des familles rurales et annoncent une insécurité alimentaire aggravée pour l’hiver.
Les infrastructures vitales ont été décimées : 21 centres de santé endommagés, dont un totalement détruit, plus de 300 écoles effondrées ou fissurées, 130 points d’eau contaminés ou inutilisables. La reconstruction coûtera bien plus cher que les dommages directs : jusqu’à 2,5 fois plus si l’on applique le principe du « build back better » – reconstruire plus sûr, plus solide, plus durable. Or, l’Afghanistan ne dispose d’aucune capacité nationale pour une telle entreprise. L’administration talibane n’a ni les compétences techniques ni les ressources financières nécessaires, et la suspension de l’aide internationale après 2021 a laissé un vide béant.
Le poids de la fragilité et de la guerre
Le rapport de la Banque mondiale ne se limite pas aux chiffres : il met en lumière le nexus entre fragilité, conflit et catastrophe. L’Afghanistan, souligne-t-il, est un pays où chaque choc naturel est amplifié par la pauvreté, la désorganisation et la défiance. L’Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA), autrefois appuyée par des partenaires internationaux, fonctionne aujourd’hui avec des moyens dérisoires. Les Talibans ont tenté de coordonner les secours, mais leur manque de transparence et la méfiance des ONG internationales ont ralenti l’aide. Des villages entiers sont restés coupés du monde pendant des semaines.
Les déplacements de population aggravent encore la situation : depuis janvier 2025, 1,8 million d’Afghans expulsés du Pakistan ont regagné leur pays, souvent sans abri ni ressources. Beaucoup se sont installés précisément dans les zones les plus touchées par le séisme. L’afflux de réfugiés, combiné à la destruction des infrastructures, crée un risque humanitaire majeur.
Les femmes, premières victimes
Comme toujours en Afghanistan, les femmes payent le prix le plus lourd. Selon les données du rapport, 52 % des morts et 54 % des blessés sont des femmes et des filles. Elles sont aussi 60 % parmi les personnes toujours portées disparues. Piégées dans des maisons fragiles dont elles ne peuvent souvent pas sortir seules, elles ont été écrasées sous les décombres. Celles qui ont survécu vivent désormais dans des camps de fortune, sans intimité, sans accès à l’eau ou aux soins. Le rapport cite l’UNICEF et le PNUD : la catastrophe risque d’aggraver durablement les inégalités de genre, en privant les femmes de leurs maigres moyens de subsistance. L’effondrement des écoles, où la scolarisation féminine était déjà interdite au-delà du primaire, achève d’effacer les dernières traces de progrès.
L’économie domestique, en grande partie assurée par les femmes à travers l’élevage et la transformation laitière, a été anéantie. Les pertes agricoles deviennent ainsi aussi des pertes sociales : dans ce système patriarcal, l’appauvrissement des femmes réduit encore leur autonomie, leur visibilité et leur voix.
Une vulnérabilité systémique
Le rapport GRADE met en évidence une corrélation entre intensité des dégâts et vulnérabilité socio-économique. Dans les districts les plus pauvres et les plus enclavés — Ghaziabad, Shegal Wa Shiltan, Dara-e-Pech ou Achen — les destructions se combinent à des taux élevés de mortalité, de déplacement et de manque d’accès à la santé. Les infrastructures essentielles — routes, hôpitaux, canaux d’irrigation — y étaient déjà déficientes avant le séisme. En d’autres termes, le désastre n’a pas frappé au hasard : il s’est abattu sur les zones les plus démunies, transformant la pauvreté en fatalité.
Cette situation met en lumière le coût de l’absence de gouvernance. Sans codes de construction, sans plan d’aménagement du territoire, sans système d’alerte ni politique de prévention, l’Afghanistan demeure l’un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles.
Reconstruire ou abandonner ?
Le rapport appelle à une réponse internationale urgente et coordonnée. Il ne s’agit pas seulement de reconstruire des bâtiments, mais de rebâtir la résilience. Cela implique de soutenir les capacités locales, de former des ingénieurs et artisans aux techniques parasismiques, de réhabiliter les réseaux d’eau et d’assainissement, et surtout, d’intégrer les femmes et les communautés locales dans la planification.
Pourtant, l’aide internationale reste timide. Beaucoup de bailleurs hésitent à financer des programmes dans un pays dirigé par les Talibans. Cette réticence politique a un coût humain immense. La Banque mondiale, en publiant ce rapport, tente de maintenir une base de données technique et neutre qui puisse servir de référence pour l’action humanitaire, quel que soit le contexte politique.
Un avertissement pour l’avenir
Ce séisme de 2025 n’est pas un événement isolé, mais un signal d’alarme. Il rappelle que l’Afghanistan, au carrefour des plaques tectoniques, est condamné à revivre ces drames si rien n’est fait pour réduire sa vulnérabilité. Dans un pays où la science est marginalisée, où la planification urbaine est absente, et où les priorités politiques tournent autour du contrôle idéologique, la prévention des catastrophes reste un luxe inaccessible.
L’Afghanistan vit aujourd’hui dans une triple secousse : géologique, politique et sociale. Chacune renforce les deux autres. Et tant que les Afghans resteront privés d’un État légitime, d’institutions solides et de liberté d’action, le pays demeurera une terre où la moindre vibration peut se transformer en tragédie.
Ce rapport GRADE n’est donc pas seulement une évaluation technique : c’est un miroir de la fragilité d’un pays et de l’indifférence du monde. Sous les décombres de Kunarha et de Nangarhar, ce sont les fissures d’une nation entière que l’on aperçoit. Si rien ne change, les prochains séismes, qu’ils soient naturels ou politiques, emporteront bien plus que des maisons : ils enseveliront définitivement l’espoir d’un avenir stable pour le peuple afghan.



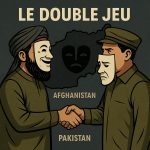





Comments are closed