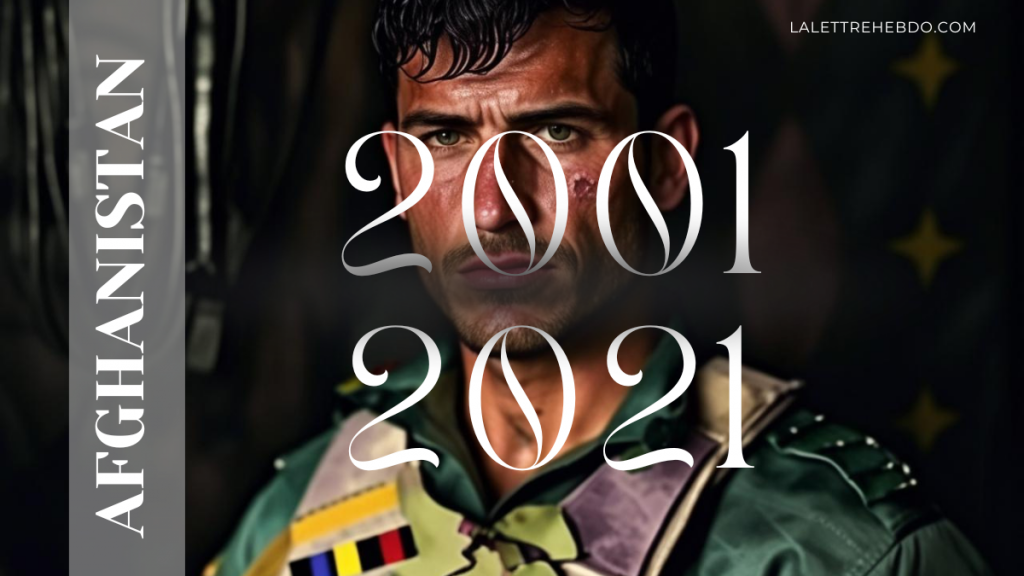Rétablir la vérité
On a trop lu que l’armée afghane s’était écroulée sans combattre. C’est faux. L’armée nationale afghane a perdu plus de 70 000 hommes au combat contre les talibans. Elle s’est battue, province après province, dans l’ombre d’un accord de Doha signé par les Américains sans le gouvernement afghan, livrant le pays à ses bourreaux. Ce marché conclu derrière son dos, suivi de la fuite des dirigeants politiques afghans, a porté le coup de grâce à une armée déjà épuisée, démoralisée, privée de logistique aérienne et de maintenance pour ses armements, à qui le Président Ghani a demandé de rendre les arme avant de s’enfuir. Ce n’est pas une défaite honteuse : c’est un abandon organisé.
Le 15 août 2021, Kaboul tombait. Les avions de l’aéroport se remplissaient de visages hagards, d’hommes et de femmes qui savaient qu’ils ne reviendraient pas. Dans les rues, la peur était palpable : ministères vidés à la hâte, drapeaux arrachés, uniformes brûlés pour ne pas être reconnus. Cette nuit-là n’était pas seulement celle de la capitale, mais celle d’un pays tout entier. Les écoles se sont fermées aux filles, les voix libres se sont tues, les femmes ont disparu de l’espace public, et chaque maison est devenue une forteresse de silence pour échapper aux rafles.
Quatre ans plus tard, cette nuit talibane s’est épaissie : interdictions toujours plus nombreuses, exécutions sommaires, prisons pleines d’opposants, marché noir de la peur et de la survie. Le monde détourne le regard, préférant oublier ce qui s’est joué.
Pourtant, sous cette chape, il reste des braises : les résistances féminines qui bravent les interdits, les voix clandestines qui transmettent la vérité, les jeunes qui rêvent encore d’un autre pays… et les commandos de la résistance armée, qui se battent encore, dans les vallées comme dans les villes, souvent au prix de leur vie. Ces forces éparses portent la flamme de l’espoir que ni la peur ni la propagande ne peuvent éteindre.
Tout au long de la semaine, La Lettre d’Afghanistan vous invite à revivre ces quatre années à travers des reportages inédits et des témoignages bouleversants : ceux d’un soldat abandonné avec ses commandos et d’un général qui voulait sauver une partie de l’armée afghane, d’un autre général exfiltré par les Français et de ceux qui n’ont pas accepté cet abandon, des récits qui donnent chair à l’Histoire et conservent la mémoire de cette nuit talibane, pour qu’elle ne soit jamais oubliée.
L’Effondrement de l’Afghanistan
Une analyse infographique des facteurs clés qui ont conduit à la chute de la République Islamique d’Afghanistan en août 2021.
1. L’Accord de la Discorde
Signé en février 2020, l’Accord de Doha a été le catalyseur diplomatique. Négocié directement entre les États-Unis et les Talibans, il a fondamentalement marginalisé le gouvernement afghan, sapant sa légitimité et son moral.
États-Unis
- Retrait complet des forces en 14 mois.
- Libération de 5000 prisonniers talibans.
- Levée des sanctions contre les Talibans.
Gouvernement Afghan EXCLU
Talibans
- Empêcher Al-Qaïda d’opérer en Afghanistan.
- Entamer des négociations intra-afghanes.
- Ne pas attaquer les forces américaines.
2. Une Armée sous Perfusion
L’Armée Nationale Afghane (ANA) a été construite sur une dépendance quasi totale au soutien logistique et technique américain. Ce talon d’Achille a été exposé de manière fatale lors du retrait.
Maintenance Externalisée
Plus de 80% de la maintenance des équipements vitaux (aviation, blindés) dépendait de contractants civils étrangers.
$90 Milliards
Investis par les USA pour former et équiper l’ANA entre 2001 et 2021.
< 33%
De la flotte aérienne afghane était opérationnelle en août 2021 après le départ des techniciens.
3. La Chute Libre : Mai – Août 2021
Coïncidant avec le retrait américain, l’offensive des Talibans a été fulgurante. Privée de soutien aérien et logistique, l’ANA s’est effondrée province par province en à peine trois mois.
Districts Capturés par les Talibans (Cumulatif)
2 Juillet
Les USA quittent la base de Bagram, centre névralgique, sans préavis.
6 Août
Chute de Zaranj, la première capitale provinciale.
15 Août
Les Talibans entrent dans Kaboul. Le gouvernement s’effondre.
4. Les Maux Internes de l’Armée
Au-delà de la dépendance, l’ANA était rongée de l’intérieur par des problèmes structurels qui ont anéanti sa cohésion et sa volonté de se battre.
Impact Illustratif des Facteurs de Faiblesse
Corruption Endémique
Le phénomène des « soldats fantômes » et le détournement de ressources (carburant, munitions) ont miné les effectifs réels et la confiance.
Moral en Berne
Le sentiment d’abandon, les salaires impayés et le manque de soutien ont détruit la volonté de combattre des soldats.
Commandement Politisé
La nomination de commandants basée sur la loyauté politique plutôt que sur la compétence militaire a paralysé la prise de décision stratégique.
5. L’Ombre du Voisin
Le soutien historique et continu du Pakistan a fourni aux Talibans des sanctuaires, des ressources et un appui logistique cruciaux pour leur survie et leur victoire finale.
Une Chaîne de Soutien Stratégique
Pakistan (ISI)
Fourniture de sanctuaires, financement, formation
Réseau Haqqani
Proxy et bras armé, opérations transfrontalières
Talibans
Capacité de mener une insurrection durable
Cette « profondeur stratégique » a permis aux Talibans de se regrouper et de planifier leurs offensives depuis des zones sûres, créant un déséquilibre fatal sur le champ de bataille.
Août 2021 : La Chute de la République Islamique d’Afghanistan
Pour une analyse encore plus détaillée, vous pouvez consulter ce rapport
La défaite soudaine et spectaculaire de la République Islamique d’Afghanistan en août 2021 face aux Talibans a marqué un tournant majeur dans l’histoire de la région. Cette chute, rapide et inattendue pour beaucoup, est le résultat d’une convergence de facteurs complexes, à la fois diplomatiques, militaires et logistiques. Ce rapport explore les éléments clés qui ont conduit à l’effondrement du gouvernement afghan, en mettant l’accent sur l’accord de Doha, le retrait du soutien américain, le manque de préparation de l’armée afghane et l’implication présumée du Pakistan.
L’Accord de Doha : Un Traité Controversé à l’origine de la déroute
Signé le 29 février 2020 entre les États-Unis et les Talibans, l’accord de Doha est considéré par de nombreux experts comme le point de départ de l’effondrement. Négocié sous l’administration Trump, cet accord visait à un retrait total des forces américaines en échange de promesses des Talibans de ne pas laisser l’Afghanistan devenir un sanctuaire pour des groupes terroristes et d’entamer des négociations de paix avec le gouvernement afghan.
Cependant, cet accord a été vivement critiqué pour plusieurs raisons :
-
Exclusion du gouvernement afghan : Le gouvernement de Kaboul, internationalement reconnu, a été exclu des négociations, ce qui a fondamentalement sapé sa légitimité et son autorité. Cet acte a envoyé un message clair aux Talibans : ils étaient les seuls interlocuteurs valables pour les Américains.
-
Manque de mécanismes de contrôle : L’accord ne comportait pas de mécanismes d’application solides pour garantir que les Talibans respectent leurs engagements. Les Talibans ont pu continuer leurs offensives et violer les accords sans conséquences significatives.
-
Légitimation des Talibans : En négociant directement avec eux, les États-Unis ont conféré une légitimité politique aux Talibans, affaiblissant par la même occasion le gouvernement en place.
Cet accord a semé le doute au sein de la population afghane et a eu un effet démoralisateur sur les forces armées, qui se sont senties abandonnées par leur principal allié.
Le Retrait Brutal du Soutien Logistique Américain
L’armée nationale afghane (ANA), financée et formée par les États-Unis pendant vingt ans, était entièrement dépendante du soutien logistique américain. Ce soutien ne se limitait pas aux armes, mais englobait des éléments vitaux pour son fonctionnement :
-
Dépendance de l’aviation : L’ANA reposait sur l’aviation pour la reconnaissance, les frappes aériennes, le transport de troupes et le ravitaillement. La maintenance de ces appareils (hélicoptères Black Hawk, avions Super Tucano, etc.) était assurée à plus de 80 % par des sous-traitants civils occidentaux.
-
Logistique externalisée : Les systèmes de ravitaillement en pièces détachées, de suivi des munitions et de planification des opérations étaient gérés depuis les bases américaines comme celle de Bagram.
Le retrait de l’administration Biden, annoncé en avril 2021, a coupé brutalement ce soutien logistique. Les techniciens civils ont quitté le pays, les bases ont été fermées (notamment celle de Bagram, sans prévenir les autorités afghanes), et les programmes de maintenance ont été interrompus. En quelques semaines, l’armée afghane s’est retrouvée sans support aérien, avec des véhicules blindés et des systèmes d’armes immobilisés faute de pièces de rechange. Les garnisons isolées, autrefois ravitaillées par air, ont été coupées de tout approvisionnement, les rendant vulnérables aux Talibans.
Cet abandon logistique a transformé l’ANA en une force désarmée et aveugle, accélérant son effondrement. Des rapports du SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) avaient pourtant averti que l’armée afghane ne pourrait pas survivre seule plus de quelques mois sans ce soutien technique.
Le Manque de Préparation et de Résilience de l’Armée Afghane
Bien que l’armée afghane ait été équipée et entraînée, elle a montré un manque de préparation et de résilience face à l’offensive des Talibans. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faiblesse :
-
Dépendance totale : L’ANA n’a jamais pu développer les capacités techniques et logistiques nécessaires pour fonctionner de manière autonome. Sa structure entière était conçue pour opérer avec le soutien constant de l’infrastructure américaine.
-
Problèmes de corruption et de moral : L’armée était minée par une corruption endémique, des soldats fantômes (soldats inscrits sur la liste de paie mais n’existant pas), et des problèmes de moral. Le manque de soutien et de renforts a renforcé ce sentiment d’abandon.
-
Absence de commandement : Le commandement et la coordination entre les différentes unités étaient souvent défaillants. Une fois le soutien logistique américain retiré, les troupes se sont retrouvées isolées et incapables de se coordonner efficacement pour résister.
La démoralisation a été un facteur décisif. Les soldats, conscients que l’aide américaine avait cessé, n’avaient plus la volonté de se battre pour un gouvernement qui semblait les avoir abandonnés. L’absence de volonté politique du gouvernement de Kaboul pour résister a été le coup de grâce.
L’Appui Logistique du Pakistan aux Talibans
Le rôle du Pakistan dans l’ascension des Talibans est un sujet de débat intense. Le Pakistan a longtemps été accusé de fournir un soutien logistique et un sanctuaire aux Talibans, en particulier via le réseau Haqqani, un groupe allié aux Talibans et considéré comme un atout stratégique pour le Pakistan.
Ce soutien aurait été crucial, notamment dans la région du Panjshir, la seule province qui a tenté de résister aux Talibans après la chute de Kaboul. Des rapports et des témoignages ont suggéré que l’Armée de l’air pakistanaise a fourni un soutien aérien aux Talibans dans le Panjshir, permettant de neutraliser la résistance. Le Pakistan aurait ainsi utilisé les Talibans comme un moyen de maintenir son influence en Afghanistan et de contrer les ambitions de ses rivaux régionaux, comme l’Inde et l’Iran.
En conclusion, l’effondrement de la République Islamique d’Afghanistan n’est pas le fruit d’une simple victoire militaire des Talibans, mais le résultat d’un processus multifactoriel. L’accord de Doha, le retrait précipité du soutien logistique américain, la faiblesse intrinsèque de l’armée afghane et le soutien pakistanais aux Talibans ont créé une situation intenable pour le gouvernement afghan. Cette défaite a des conséquences humanitaires et géopolitiques majeures, et elle sert de leçon sur les dangers de la dépendance militaire et des négociations de paix non inclusives.
Vingt ans de guerre : les chiffres qu’on oublie
On a trop souvent réduit la guerre d’Afghanistan à un affrontement asymétrique où l’Occident aurait perdu patience, oubliant de rappeler son coût humain colossal. Entre 2001 et 2021, ce sont près de 70 000 soldats et policiers afghans qui ont été tués, saignant à blanc une armée qui a combattu jusqu’à l’épuisement. Du côté de la coalition internationale, 3 621 militaires étrangers ont perdu la vie
-
Total des morts de la coalition : 3 621
Le tableau suivant détaille les décès par pays (chiffres exacts disponibles dans l’article d’origine) ; voici quelques exemples notables :
-
États-Unis : environ 2 461 morts
-
Royaume-Uni : 457 morts
-
Canada : 159 morts
et 90 Français
Ces chiffres incluent également des pays comme l’Australie (41 tués), la France (90), l’Allemagne (62, dont 59 soldats + 3 officiers), l’Italie (53), les Pays‑Bas (25), la Pologne (44), la Roumanie (27), la Norvège (10), l’Espagne (35), la Suède (5), le Danemark (43), l’Albanie (1), la Belgique (1), la Bulgarie (1), le Portugal (2), la Turquie (nombre variable selon incidents) et le Monténégro (1)
Les civils ont payé le prix lourd : au minimum 46 319 morts documentés, et jusqu’à 170 000 selon certaines estimations, sans compter les centaines de milliers de décès indirects causés par la faim, les maladies ou l’effondrement des infrastructures.
Et face à eux ? Les pertes talibanes, estimées à environ 52 893 combattants, restent très inférieures à celles des forces de sécurité afghanes. Ce déséquilibre en dit long : pendant que les talibans pouvaient se replier, se régénérer et trouver refuge au Pakistan, les soldats afghans combattaient en première ligne, souvent seuls, pour défendre un pays que la communauté internationale allait finalement abandonner.
Vingt ans après, ces chiffres rappellent que la défaite n’est pas toujours militaire : elle peut aussi être politique, et ce sont alors les plus dévoués qui paient le prix fort.