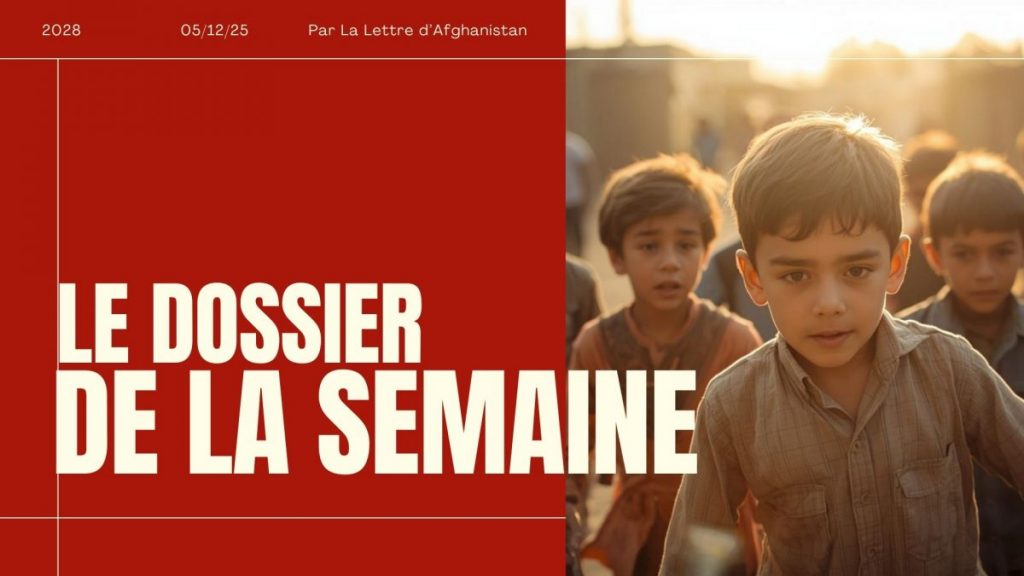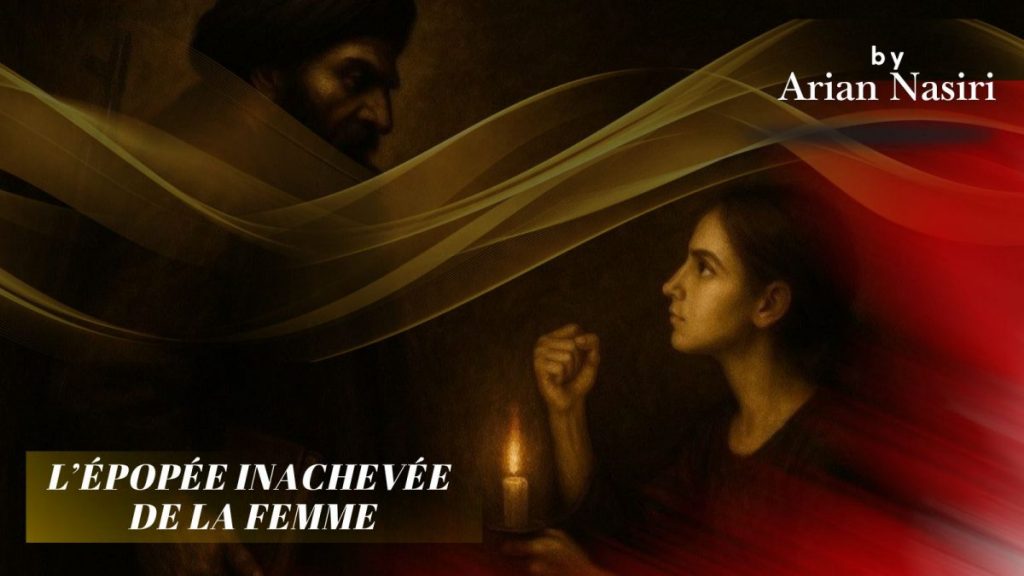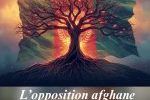Le 3 juillet 2025, la Russie de Vladimir Poutine a officiellement reconnu le régime taliban comme gouvernement légitime de l’Afghanistan. Cette décision, qui marque une rupture historique, a été largement dénoncée dans les capitales occidentales et accueillie avec stupeur par l’opinion internationale. Nombre d’observateurs ont immédiatement pointé du doigt la division chronique de l’opposition afghane comme cause de ce basculement. Si les opposants aux Talibans avaient parlé d’une seule voix, disent-ils, Moscou aurait peut-être reculé.
Mais cette lecture — purement tactique — ignore une réalité plus fondamentale : l’opposition afghane a sans doute évité l’irréparable en ne quémandant pas la reconnaissance d’un régime honni, isolé, et discrédité à l’échelle mondiale. Car s’unir pour être adoubé par le Kremlin, c’eût été, à terme, signer sa propre mort diplomatique.
Ce que la Russie représente aujourd’hui : un poison pour toute cause juste
Il ne faut pas se tromper de décor. La Russie de 2025 n’est pas un acteur géopolitique neutre ou même respectable. Elle est devenue un empire agressif, accusé de crimes de guerre en Ukraine, d’ingérences massives dans les processus électoraux occidentaux, et d’élimination systématique des dissidents. Son drapeau est aujourd’hui synonyme, dans les opinions publiques libres, de répression, de mensonge d’État, et de déstabilisation.
Dans ce contexte, être soutenu par la Russie ne vaut plus rien. Pire : cela détruit toute crédibilité. On ne compte plus les groupes, partis ou mouvements de par le monde qui ont vu leur légitimité s’effondrer dès lors qu’ils ont été perçus comme inféodés à Moscou. Les opposants afghans auraient-ils pu continuer à parler de démocratie, de droits humains, de liberté, s’ils avaient été associés à un régime qui nie tout cela en acte et en discours ? Non. Ils auraient été immédiatement disqualifiés auprès de toutes les institutions internationales sérieuses — et dans l’esprit des peuples qu’ils prétendent défendre.
L’éthique par défaut, ou le refus de la compromission
C’est pourquoi la division de l’opposition afghane ne doit pas être lue uniquement comme un échec. Elle peut — paradoxalement — être ce qui l’a sauvée. Car cette absence d’unité a empêché la formation d’un bloc opportuniste prêt à tout pour obtenir l’onction de Moscou. Elle a bloqué le scénario cauchemardesque d’un « front de la résistance » transformé en faire-valoir d’un Poutine manipulateur, soucieux de redorer son image musulmane et de saboter toute tentative occidentale de solution politique.
En refusant de pactiser avec le Kremlin, l’opposition afghane a préservé l’essentiel : sa dignité. Elle n’a pas cédé au cynisme. Elle n’a pas troqué l’indignation contre la visibilité. Elle a choisi de rester fidèle à ses principes, quitte à être marginalisée à court terme.
Le piège évité : la mort lente de la respectabilité internationale
Reconnaître les Talibans, pour la Russie, c’est surtout envoyer un signal : celui de la guerre aux valeurs démocratiques. Si l’opposition afghane s’était liée à ce projet, même indirectement, elle aurait été piégée. Elle aurait été assimilée à un bloc d’autocraties islamo-nationalistes — Iran, Chine, Russie, Syrie — qui se nourrissent de la souffrance des peuples au nom de la stabilité.
Le soutien russe aurait été un baiser de la mort. Une cause noble, celle de la liberté afghane, serait devenue inaudible. Le silence des démocraties face à l’opposition aurait été plus lourd encore. Et la diaspora, éclatée mais exigeante, se serait détournée.
Ce qu’il faut faire maintenant : construire sans se vendre
Refuser Moscou est une chose. Encore faut-il proposer autre chose. L’opposition afghane doit à présent construire une structure nouvelle, affranchie des tuteurs toxiques, visible, cohérente, ancrée dans les valeurs universelles et les droits humains. Cela exige de dépasser les égos, les rivalités historiques, et les calculs ethniques.
Il faut une voix afghane forte, indépendante, multilingue, crédible, capable de parler à la fois aux institutions occidentales et aux peuples musulmans. Une voix qui ne court pas après les faveurs des puissances, mais qui défend une vision de société fondée sur la liberté, la justice, l’égalité hommes-femmes, et la dignité humaine.
Conclure autrement : la force du refus
L’histoire retiendra peut-être que l’opposition afghane a échoué à s’unir. Mais elle retiendra aussi, et peut-être surtout, qu’elle n’a pas trahi. Elle n’a pas vendu son honneur pour un strapontin à Moscou. Elle a gardé sa parole. Et dans un monde saturé de compromissions, cela vaut plus que toutes les reconnaissances.
L’Afghanistan libre ne se construira ni avec les Talibans, ni avec leurs parrains autoritaires. Il se construira avec ceux qui auront su résister à la fois aux armes et aux tentations du pouvoir sans âme.
À lire aussi