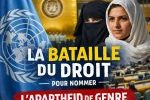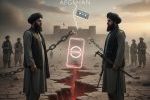Par Nigara Mirdad – Conseillère politique, Ambassade d’Afghanistan à Varsovie
(Publié le 21 octobre 2025 par Sonny Batrouni, rédacteur en chef de Prognoznews.co.uk)
Un nouveau chapitre du paysage politique afghan s’est ouvert après août 2021. L’ascension impitoyable des Talibans au pouvoir a bouleversé de manière irréversible la scène politique du pays et modifié l’équilibre des forces, tant au niveau régional que mondial.
Cette étude examine minutieusement les politiques des Talibans à travers le prisme des réalités de terrain, de leurs ambitions géopolitiques et de leurs engagements internationaux, afin d’offrir une vision sans fard de la situation actuelle de l’Afghanistan. Après avoir pris le pouvoir par la force militaire, les Talibans ont centralisé l’autorité au sein du Conseil de direction de Kandahar. La sécurité s’est considérablement dégradée, malgré la fin des grandes offensives et une certaine stabilité apparente dans quelques villes.
Les exactions des Talibans contre les individus se poursuivent sans relâche. Des témoignages crédibles signalent l’élimination d’anciens membres des forces de sécurité, des discriminations fondées sur l’ethnie, la langue et la religion, des déplacements forcés, le ciblage stratégique des citoyens instruits et une répression culturelle manifeste — notamment à travers la marginalisation de la langue persane dans les institutions publiques et la manipulation du système éducatif. Ces pratiques menacent gravement la diversité culturelle et linguistique du pays ainsi que son identité nationale.
Les Talibans maintiennent leur emprise grâce à un savant mélange de réseaux traditionnels de loyauté ethnique et religieuse — une « harmonie culturelle » qui, en réalité, masque une autorité coercitive. Les tensions ethniques et la gouvernance brutale ont transformé la « sécurité » en simple façade plutôt qu’en fondement solide. En Afghanistan, la sécurité consiste davantage à faire taire la population qu’à gagner sa confiance.
L’émergence d’environ vingt et un groupes terroristes, la résurgence d’État islamique – Khorasan (EI-K) avec des combattants revenus de Syrie, le réveil d’al-Qaïda et la collusion croissante entre les Talibans et le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ont provoqué un désordre régional majeur. Le trafic de drogue et les déplacements massifs de populations fuyant le régime tyrannique taliban constituent des menaces graves pour l’équilibre régional. Face à ces risques, les pays voisins ont choisi d’accommoder les Talibans, espérant se protéger d’un débordement terroriste tout en profitant de la situation fragile du pays. Ces relations, toutefois, servent avant tout leurs propres intérêts.
Les Talibans, de concert avec leurs alliés étrangers, ont exploité habilement les entreprises régionales qui tirent parti des ressources naturelles et minières de l’Afghanistan, au moyen de contrats souvent opaques et trompeurs. Dans leurs relations extérieures, les Talibans pratiquent un calcul froid, alliant pragmatisme tactique et continuité doctrinale pour défendre leurs propres objectifs. Bien qu’ils aient établi des liens avec des puissances régionales majeures — la Chine, l’Iran, la Russie, le Qatar et le Pakistan — ces alliances visent avant tout leurs propres avantages, non le bien du peuple afghan.
Les Talibans affirment que leur politique étrangère repose sur quatre piliers : préserver l’indépendance nationale, empêcher toute intervention militaire étrangère, attirer les investissements commerciaux et de transit, et prévenir le terrorisme sur le sol afghan. Ils ont échoué sur tous ces fronts. Les États-Unis conservent le contrôle de l’espace aérien afghan en vertu de l’accord de Doha. L’Iran et le Pakistan ont signalé des attaques transfrontalières menées depuis l’Afghanistan, tandis que les droits civiques y sont totalement abolis. Les politiques des Talibans demeurent donc essentiellement déclaratives.
La dépendance vis-à-vis des gouvernements voisins et de l’aide humanitaire internationale a fortement compromis les prétentions d’indépendance du régime, transformant sa politique étrangère en un exercice d’équilibrisme constant entre pressions internes et contraintes extérieures.
Les restrictions imposées aux femmes en matière d’éducation, d’emploi et de participation sociale et politique constituent des obstacles colossaux. La décision des Talibans d’interdire l’éducation des filles au-delà du primaire, d’exclure les femmes du secteur public et privé, et d’imposer des règles strictes sur la tenue et le comportement en public a provoqué une crise humanitaire majeure et détruit la légitimité morale du régime, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Tragiquement, lors du séisme de Kunar, ces restrictions ont conduit à un nombre de victimes particulièrement élevé parmi les femmes et les enfants.
La communauté internationale s’indigne du mépris flagrant de l’Afghanistan pour les accords mondiaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la CEDAW. Les Talibans soutiennent que ces mesures s’alignent sur la « charia », mais leur position est condamnée par plusieurs pays musulmans et par l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Ces dérives ont isolé l’Afghanistan sur le plan diplomatique et anéanti ses ressources humaines.
Vingt années de démocratie avaient permis aux femmes de progresser dans l’éducation, la participation politique et l’autonomie sociale ; les Talibans ont démantelé en quelques mois ces acquis durement conquis. L’Afghanistan est aujourd’hui piégé dans une tourmente économique : son économie s’est adaptée aux réalités du commerce informel, des transferts de fonds et des échanges frontaliers, conséquence des sanctions internationales, de la suspension de l’aide étrangère et de l’effondrement du système bancaire officiel.
Le régime se finance principalement par les recettes douanières, l’exploitation minière et le commerce informel. Ces ressources génèrent des revenus immédiats, mais alimentent la corruption systémique, enrichissent les chefs locaux et sapent les institutions publiques. Sans transparence financière ni système fiscal efficace, l’économie afghane se trouve au bord du gouffre, incapable d’attirer les investissements étrangers.
La base aérienne de Bagram — jadis symbole de la puissance militaire étrangère et de l’intervention internationale — incarne désormais la confrontation entre idéaux élevés et réalités politiques brutales.
Un retour direct des États-Unis à Bagram semble peu probable, mais une approche plus discrète, combinant partage de renseignements et coopération avec des alliés régionaux, reste envisageable. Les failles des Talibans en matière de sécurité et de renseignement pourraient même favoriser une telle implication indirecte occidentale.
Washington aurait déjà discuté secrètement avec certains pays d’Asie centrale pour surveiller l’EI-K. Bien que les Talibans rejettent toute présence étrangère, leurs insuffisances en matière de renseignement ouvrent la porte à une influence occidentale via la technologie et la coopération sécuritaire.
Les pays occidentaux et d’Asie centrale redoutent l’extrémisme religieux : les Talibans ont fondé plus de 18 000 madrassas en quatre ans, ce qui représente une menace sécuritaire majeure. À cela s’ajoute la pauvreté grandissante de plus de 28 millions d’Afghans, privés du nécessaire, offrant un terreau fertile au recrutement par l’EI et al-Qaïda.
Bien que les Talibans proclament leur autonomie, la stabilité véritable leur échappe sans une interaction stratégique avec les puissances mondiales. Si cette situation est ignorée, l’Afghanistan pourrait redevenir un champ de bataille pour les ambitions géopolitiques concurrentes. Bagram dépasse sa fonction militaire : elle symbolise le conflit entre la fierté nationale afghane et les dures nécessités du réel.
Le principal défi des Talibans réside dans la transition d’un esprit djihadiste vers une gouvernance politique effective. Leur administration inefficace a transformé l’Afghanistan en paria international, privé de toute légitimité politique. Des politiques à la fois exclusives et oppressives — notamment envers les femmes et les minorités ethniques — ont miné la légitimité interne et détérioré les relations internationales.
Les grandes puissances affirment que leur engagement avec les Talibans dépend du respect des droits humains, mais les progrès concrets restent inexistants. L’avenir de l’Afghanistan dépendra d’une gouvernance stratégique, d’une diplomatie habile et d’une approche lucide de ses intérêts nationaux. Le pays se trouve dans une transition périlleuse, oscillant entre le joug théocratique et la promesse insaisissable de stabilité politique.
Sans gouvernement véritablement représentatif, l’Afghanistan restera l’échiquier des ambitions régionales. Des négociations de paix authentiques sont indispensables pour que le pays puisse redevenir un acteur souverain, responsable et respecté sur la scène régionale.