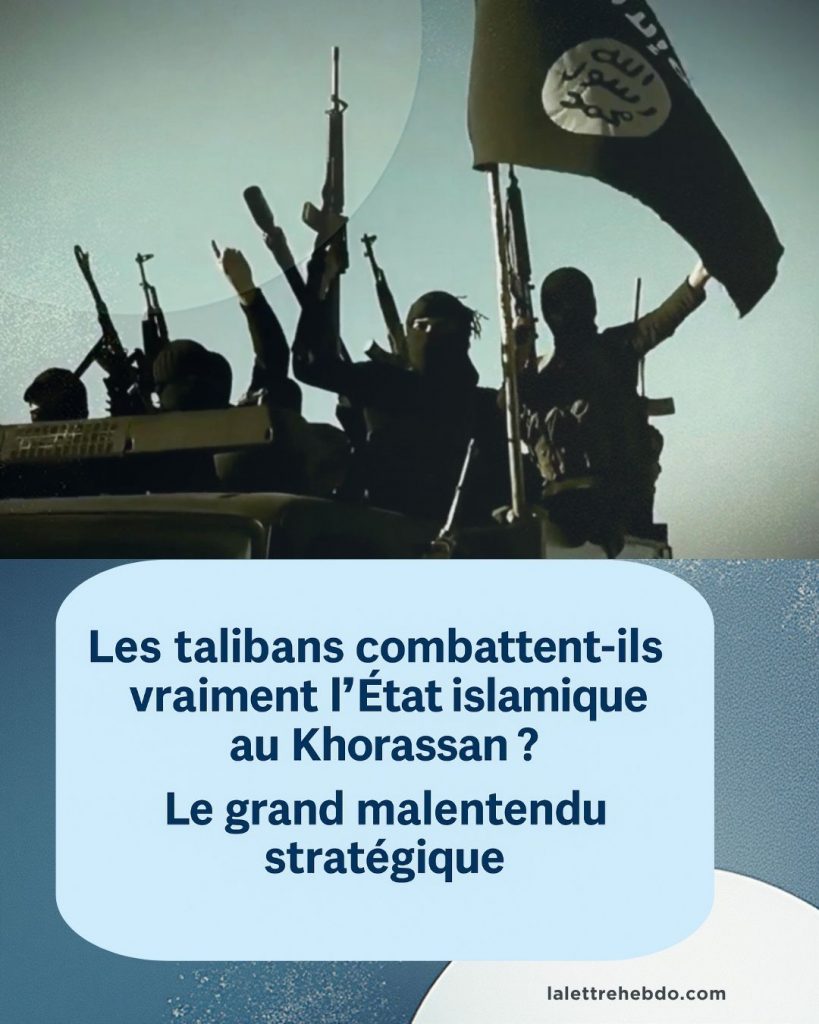
Depuis plusieurs mois, les directeurs des services de renseignement français soutiennent que la menace terroriste pesant sur l’Europe serait essentiellement “endogène”, née dans nos propres fractures et radicalités internes. Une menace sans géographie, sans arrière-base, sans stratégie extérieure. Ce récit fonctionne politiquement : il rassure. Il évite d’avoir à se confronter aux erreurs du retrait de 2021, à la reconstitution d’un sanctuaire terroriste en Afghanistan, et aux réseaux transnationaux que les talibans laissent prospérer.
Pourtant, les données de l’ONU, les analyses régionales et la réalité du terrain racontent une tout autre histoire : la menace actuelle n’est pas autonome. Elle est connectée, structurée et nourrie par l’Afghanistan taliban.
L’Afghanistan taliban : un écosystème où 21 groupes extrémistes cohabitent
Vingt-et-un groupes extrémistes opèrent aujourd’hui en Afghanistan sous la protection directe ou indirecte des talibans. Parmi eux figurent cinq organisations pakistanaises (dont le TTP et Jamaat-ul-Ahrar), des éléments centrasiatiques (IMU, KTJ, Ansarullah, IJU), des réseaux caucasiens, des contingents ayant combattu en Syrie, des cellules transnationales, ainsi qu’Al-Qaïda central, AQIS et l’État islamique au Khorassan (EI-K).
Ensemble, ces groupes représentent un potentiel global supérieur à 20 000 combattants, un chiffre inédit depuis 2001. Les effectifs étrangers ont augmenté d’environ 18 % entre 2024 et 2025, confirmant l’attractivité persistante du sanctuaire afghan. Le nord et le nord-est sont les zones les plus densément infiltrées, tandis que l’est reste le cœur opérationnel d’EI-K.
L’illusion d’une guerre talibane contre EI-K
Les talibans affirment combattre EI-K. Ils annoncent régulièrement des “victoires”, des cellules démantelées, des commandants éliminés.
Mais aucune source indépendante n’a accès aux zones de combat. Ni presse libre, ni observateurs, ni organisations internationales. Les déclarations talibanes ne reposent sur rien de vérifiable.
Au contraire, les rapports onusiens indiquent que :
– EI-K progresse,
– EI-K recrute,
– EI-K construit des réseaux,
– EI-K bénéficie du chaos institutionnel.
La prétendue “lutte” talibane sert surtout à convaincre l’Occident qu’ils seraient un rempart indispensable. Un rôle qui leur permet de chercher une reconnaissance politique progressive.
New Delhi et Islamabad : deux attentats qui révèlent la réalité
Les attaques récentes l’ont démontré avec éclat.
À New Delhi, l’explosion d’un véhicule piégé près du Fort Rouge rappelle les méthodes des réseaux indo-pakistanais renforcés via l’Afghanistan.
À Islamabad, un kamikaze a frappé près d’un tribunal, provoquant de nombreuses victimes. La faction Jamaat-ul-Ahrar, liée au TTP présent en Afghanistan, a revendiqué avant que le TTP central ne brouille les pistes.
Ces attentats montrent que le sanctuaire afghan produit déjà des effets régionaux. La menace circule, franchit les frontières, se projette.
Elles démontrent surtout que la doctrine française d’une menace “endogène” ne résiste pas à la réalité.
Une doctrine française construite sur un déni stratégique
Pourquoi persister à affirmer que la menace serait interne ?
Parce qu’admettre le contraire reviendrait à reconnaître :
– que l’Afghanistan est redevenu un sanctuaire,
– que l’Europe n’a plus d’accès au terrain,
– que les talibans mentent lorsqu’ils prétendent lutter contre EI-K,
– que les choix diplomatiques récents reposent sur de fausses prémisses.
Il est politiquement plus simple de parler d’un individu radicalisé que d’un réseau structuré. Plus confortable d’évoquer une fragilité sociale que de constater la recomposition d’un écosystème terroriste international.
Le précédent sahélien : un avertissement ignoré
Ce qui a été démontré au Sahel s’applique désormais à l’Afghanistan : lorsque les signaux faibles s’accumulent, que les groupes se recomposent et que les sanctuaires prospèrent, l’Occident nie, temporise, minimise. Puis un jour, il constate que la menace a explosé.
L’Europe est aujourd’hui dans cette phase de déni. Elle observe, relativise, normalise. Jusqu’au jour où la menace se manifestera à nouveau sur son sol.
La voix d’Ahmad Massoud : un avertissement à l’Europe
Lors des “Rencontres de l’Avenir” à Saint-Raphaël, Ahmad Massoud a rappelé que plus de vingt groupes extrémistes opèrent librement sous les talibans, que le pays est devenu un corridor pour les trafics, les réseaux et les flux djihadistes.
Il a insisté : la tragédie afghane n’est pas contenue. Elle reconfigure la sécurité du Moyen-Orient, de l’Asie centrale et de l’Europe.
Il a prévenu que le silence international donne aux talibans un blanc-seing, qu’EI-K se renforce, et que l’oubli de l’Afghanistan prépare la prochaine crise mondiale.
Il a rappelé aussi que le combat de son père n’était pas un combat national mais un combat pour une sécurité internationale fondée sur la justice et la dignité.
La géopolitique du déni : croire à une menace interne
La vision française d’une menace purement “endogène” repose sur une fiction. La violence ne naît pas spontanément : elle circule, s’organise, se finance, s’inspire.
Dans un Afghanistan où Al-Qaïda, le TTP et tous les groupes identifiés opèrent librement, et où les talibans échouent à contenir EI-K, il est illusoire de présenter la menace comme endogène à l’Europe : elle se nourrit d’un environnement extérieur en pleine expansion.




