L’histoire contemporaine de l’Afghanistan est faite de guerres, d’occupations et de rivalités régionales. Mais derrière ces convulsions spectaculaires s’en déroule une autre, moins visible et tout aussi dévastatrice : la guerre des talibans contre les femmes. Depuis leur apparition dans les années 1990 jusqu’à leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont fait de l’effacement des Afghanes non pas une mesure accessoire mais la matrice de leur pouvoir. Leur rage n’est pas accidentelle, elle est systématique.
Pour qualifier ce projet, un mot s’impose, même s’il dérange : gynocide. Ce terme, forgé par la théoricienne Andrea Dworkin et repris par des féministes comme Antoinette Fouque, désigne la destruction méthodique des femmes en tant que groupe social. Là où le génocide, tel que défini par la Convention de 1948, vise l’anéantissement « d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux », le gynocide vise l’anéantissement des femmes en tant que femmes – un groupe que le droit international ne reconnaît pas encore parmi les groupes protégés.
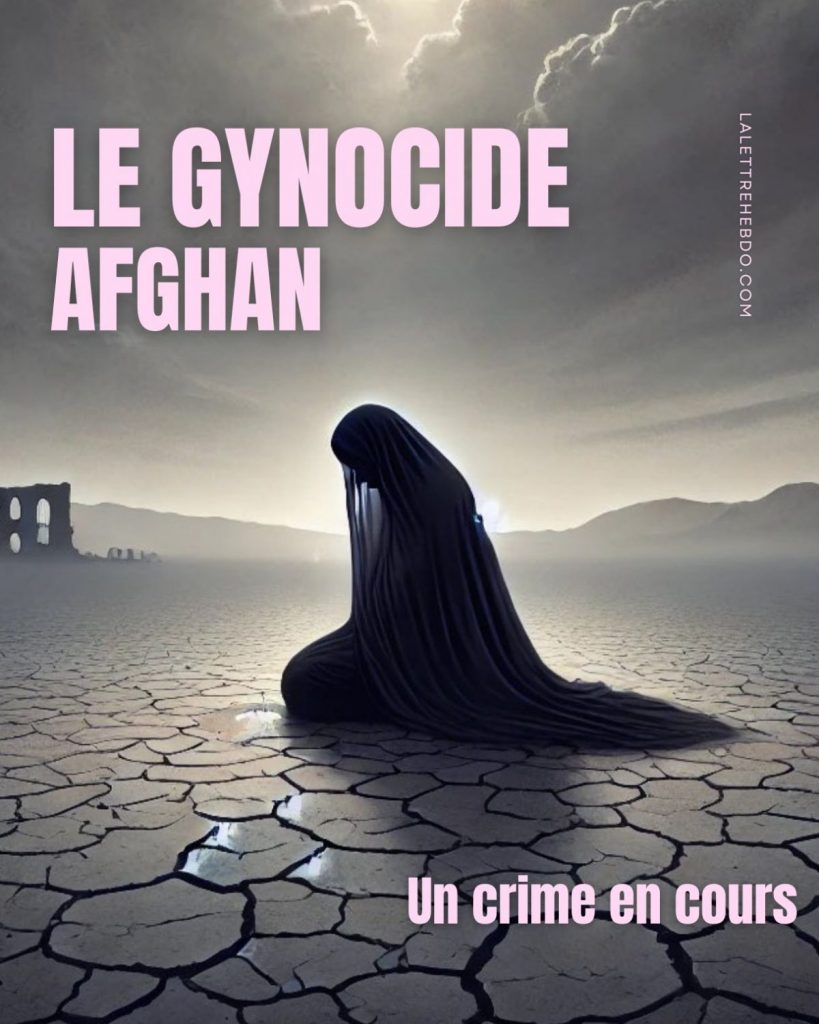
🚫 Les Afghanes sous l’emprise des talibans : un gynocide par la loi
📚 Éducation
- Collège & lycée interdits aux filles (2021)
- Université interdite (déc. 2022)
- Cours privés et en ligne fermés
- Écoles de médecine et sages-femmes interdites
💼 Travail
- Employées publiques renvoyées
- Interdiction ONG (déc. 2022)
- Interdiction ONU (avril 2023)
- Salons de beauté fermés (juil. 2023)
🚶 Liberté de mouvement
- Mahram obligatoire pour voyager
- Avion interdit sans chaperon
- Déplacements interurbains interdits
- Femmes interdites de conduire
📰 Espaces publics & médias
- Interdiction parcs, bains, salles de sport
- Voix et image supprimées des médias
- Photos et publicités féminines censurées
- Manifestations interdites
⚕️ Santé & quotidien
- Femmes soignées seulement par des femmes
- Formation médicale interdite aux étudiantes
- Retards et refus de soins fréquents
- Mariages forcés et précoces en hausse
Les limites du cadre juridique actuel
Certains contestent l’emploi de ce mot, le jugeant excessif ou dépourvu de base légale. Il est vrai que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 ne protège que les groupes « nationaux, ethniques, raciaux ou religieux ». Cette limitation n’est pas accidentelle : elle résulte d’un « processus de négociation » et « reflète le compromis obtenu par les États membres » de l’époque, qui ont explicitement exclu les groupes politiques et les formes de « génocide culturel ».
Pourtant, l’intention destructrice des talibans correspond parfaitement à l’esprit de la définition du génocide : il s’agit bien d’actes « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie » un groupe – les femmes afghanes –, notamment par la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle » et par des « mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ».
Le terme gynocide permet donc de combler une lacune conceptuelle et juridique. Tant que l’on se contente de parler de « restrictions de droits » ou de « rétrogression sociale », on sous-estime la réalité : ce qui se joue aujourd’hui en Afghanistan est une politique d’éradication systématique des femmes en tant que femmes, même si elle ne peut être poursuivie sous la qualification juridique de génocide.
Un projet ancien, une idéologie intacte
Le premier émirat islamique (1996-2001) a constitué un laboratoire du gynocide. Les écoles et les universités pour filles ont été fermées, les femmes exclues du travail, réduites à l’enfermement domestique et obligées de porter le voile intégral. Toute sortie nécessitait un mahram. Les violences étaient quotidiennes : flagellations pour un « hijab mal porté », amputations pour des « crimes moraux », lapidations pour adultère. Une femme a eu le pouce tranché pour avoir mis du vernis. Ce premier règne a déjà démontré ce que signifiait l’effacement féminin : réduire la moitié du peuple au silence, pour garantir le contrôle absolu sur l’ensemble de la société.
En août 2021, lorsque Kaboul tombe de nouveau, certains espèrent que deux décennies de changements sociaux auront modéré les talibans. Mais dès les premières semaines, les promesses de « respecter les droits des femmes dans le cadre de l’islam » volent en éclats. Les employées du secteur public sont renvoyées, les écoles secondaires pour filles ferment, les manifestations féminines sont dispersées par coups de crosse, arrestations et disparitions.
Puis vient une avalanche de décrets : interdiction d’université, interdiction de travailler dans les ONG, obligation du voile intégral, interdiction des parcs, des bains publics, des salons de beauté. Chaque interdiction vise une dimension de l’existence : apprendre, travailler, se soigner, se rencontrer, se détendre. C’est une politique d’éradication. Une mise à mort sociale qui entraîne aussi des morts physiques : mariages précoces, mortalité maternelle accrue, suicides, pauvreté extrême.
Les armes du gynocide
Les armes de ce gynocide sont multiples et répondent à la logique systémique qu’Andrea Dworkin décrivait comme « les tentatives quotidiennes de détruire les femmes ». L’éducation d’abord : interdire le lycée puis l’université aux filles, c’est condamner des générations à l’ignorance. L’Afghanistan est aujourd’hui le seul pays au monde où l’enseignement secondaire féminin est interdit, non par coutume mais par stratégie d’effacement.
L’économie ensuite : priver les Afghanes du droit de travailler, fermer les ONG à leurs employées, dissoudre les salons de beauté, c’est confisquer l’autonomie financière et réduire des veuves et des mères au rang de mendiantes. Le corps aussi : le mahram obligatoire transforme chaque déplacement en supplice, chaque soin en obstacle, chaque voyage en humiliation.
La santé : les talibans exigent des soignantes femmes, mais interdisent leur formation. Résultat : moins de personnel, plus de décès évitables, chaque grossesse devient une roulette russe. La vie sociale enfin : parcs, bains, salles de sport fermés, voix et images féminines effacées des médias. La maison devient prison, la rue territoire hostile, l’amitié elle-même un souvenir. La violence résume le tout : arrestations, tortures, coups de fouet rappellent sans cesse que la peur est la règle.
Un crime sans nom juridique
Les catastrophes récentes montrent comment ce système transforme un désastre en arme. Le 1er septembre 2025, un séisme dévaste l’Est du pays : plus de 2 200 morts, des milliers de blessés, 8 000 maisons détruites. Mais pour les Afghanes, la tragédie naturelle se double d’un crime politique. Faute de soignantes autorisées à exercer, faute de mahram pour franchir les hôpitaux, des femmes meurent de blessures traitables. Le séisme devient un gynocide par négligence.
Quelques jours plus tard, à Kaboul, les talibans interdisent aux employées afghanes de l’ONU d’entrer dans leurs bureaux. L’ordre vient d’Akhundzada. En humiliant l’ONU dans ses propres locaux, ils proclament que leur loi d’effacement des femmes prime sur tout droit international. Ces deux événements confirment la nature du projet : pas une restriction, mais un programme d’éradication assumé.
La Cour pénale internationale a bien émis des mandats d’arrêt contre Akhundzada et Haqqani pour crimes contre l’humanité liés à la persécution de genre, mais sans mise en œuvre, ces décisions restent symboliques. Car le droit international actuel, forgé en 1948 dans un monde où les droits des femmes n’étaient pas une priorité, ne dispose pas d’outils juridiques adaptés à ce type de crime systémique fondé sur le genre.
Nommer pour résister
Face à cette lacune, la communauté internationale continue pourtant de financer l’aide humanitaire, tout en tolérant que les talibans en confisquent l’accès. Chaque dollar envoyé sans condition renforce le régime et finance son appareil d’oppression. L’ONU débloque dix millions pour les victimes du séisme, mais les Afghanes, premières victimes, ne peuvent y accéder. L’aide nourrit la machine d’exclusion qu’elle prétend combattre.
Face à cette entreprise d’anéantissement, il est urgent de nommer le crime, même imparfaitement. Oui, le terme gynocide dérange, et oui, il n’a pas de valeur juridique contraignante. Mais il est le seul qui rende compte de la destruction systématique des femmes en tant que femmes, par la violence physique mais aussi par l’effacement social, économique et culturel.
Reconnaître ce crime conceptuel, c’est briser l’illusion d’une « tradition conservatrice » ou d’un simple « retour en arrière ». C’est aussi révéler les limites d’un droit international conçu il y a près d’un siècle, quand les groupes de genre n’étaient pas considérés comme dignes de protection. Nommer, c’est préparer l’évolution juridique : sanctions ciblées, isolement diplomatique, création de corridors humanitaires indépendants, et peut-être, un jour, une révision de la Convention sur le génocide.
L’universalité en question
Et malgré la terreur, les Afghanes refusent de disparaître. Cours clandestins, manifestations éclairs, textes et images diffusés à l’étranger : chaque geste devient acte révolutionnaire. Dans un régime d’effacement, persister à exister est déjà une gifle au projet taliban. Leur résistance révèle que le gynocide, contrairement au génocide physique, ne peut jamais être total tant que la moitié de l’humanité refuse de se taire.
Si un régime peut impunément instaurer un apartheid de genre aussi radical, c’est l’universalité des droits humains qui vacille. L’Afghanistan tend au monde un miroir brutal : jusqu’où tolérerons-nous qu’un gynocide se déroule à ciel ouvert, maquillé en piété ? Jusqu’à quand accepterons-nous qu’un droit international vieux de 77 ans ignore les crimes les plus systémiques contre la moitié de l’humanité ?
Le terme gynocide est contesté, mais il est temps de l’assumer comme outil de résistance conceptuelle en attendant sa possible consécration juridique. Car nommer, c’est refuser l’habitude. Nommer, c’est préparer la justice. Nommer, c’est honorer celles qui résistent. Les Afghanes ne sont pas des figurantes d’une tragédie lointaine, elles sont l’avant-garde d’un combat universel. Leur lutte révèle aussi les failles de nos instruments juridiques : une humanité qui laisse faire un gynocide sans pouvoir le nommer juridiquement abdique une part de son âme – et révèle l’urgence d’adapter le droit aux crimes d’aujourd’hui.
A LIRE ABSOLUMENT / Un gynocide en Afghanistan de Véronique Nahoum-Grappe




