La Lettre d’Afghanistan 29 octobre 2025Numéro 45
Malala Yousafzai : La normalisation des relations avec les talibans est une « trahison envers les femmes afghanes » Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix, a vivement critiqué l’approche de certains pays occidentaux envers les talibans, avertissant que la normalisation des relations avec ce groupe équivaut à une « trahison envers les femmes d’Afghanistan, une hypocrisie et une erreur ». Dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel, elle a souligné que la situation des femmes en Afghanistan est pire que jamais et qu’elles vivent sous l’ombre de la « terreur et de la peur » des talibans. Yousafzai a appelé le gouvernement allemand à revoir sa politique envers les talibans et a déclaré : « Je demande au peuple allemand de montrer sa solidarité avec le peuple afghan, de soutenir les femmes et d’écouter leur voix. » Elle a averti que légitimer les talibans revient à ignorer leurs crimes et a ajouté : « Aucun pays ne devrait normaliser ses relations avec les talibans. Les talibans doivent être tenus responsables des crimes qu’ils ont commis. » Yousafzai a précisé : « Normaliser les relations avec les talibans signifie normaliser la répression des femmes. C’est une erreur, une trahison et une hypocrisie manifeste. » Elle a fait référence à la propagande des talibans sur les réseaux sociaux, affirmant que ce groupe tente de se présenter comme pacifique, mais la réalité est que les talibans non seulement n’ont pas changé, mais sont devenus plus extrémistes et plus intelligents. Selon elle, « tant que les femmes et les filles sont opprimées, il n’y a pas de paix. » Yousafzai a également demandé que « l’apartheid sexuel » en Afghanistan soit reconnu et défini comme un crime en droit international. Elle a insisté : « La communauté internationale doit prendre au sérieux la lutte des femmes. » Cette militante des droits humains a ajouté que les talibans ont systématiquement exclu les femmes de la vie publique et que tous les acquis des deux dernières décennies pour les femmes en Afghanistan ont été anéantis. Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les Talibans ont méthodiquement détruit la liberté de la presse en Afghanistan. Human Rights Watch décrit un paysage médiatique anéanti : surveillance généralisée, censure stricte, détentions arbitraires, torture et disparition de journalistes, en particulier de femmes. Les médias restants opèrent sous la menace permanente de la police religieuse et du renseignement, tenus de diffuser des contenus « positifs » et approuvés à l’avance. Toute critique du régime, tout contact avec des médias en exil ou toute mention de désaccord interne peut mener à l’arrestation. Les journalistes Hazara subissent des discriminations encore plus violentes, victimes de tortures et d’humiliations raciales. Les femmes journalistes, quant à elles, ont quasiment disparu du paysage médiatique. Celles qui persistent à travailler sont contraintes de le faire depuis leur domicile, sous hijab, avec interdiction de parler à des hommes ou de couvrir des événements publics. Dans plusieurs provinces, leurs voix sont bannies des radios et des télévisions.
La loi sur la « propagation de la vertu et la prévention du vice » (2024) interdit toute image d’être vivant et impose la conformité à la charia. La peur a généralisé l’autocensure : la majorité des reportages se limitent à des cérémonies officielles ou à des sujets anodins. En quatre ans, plus de la moitié des médias privés ont fermé ; le nombre de journalistes masculins a chuté de 4 000 à 2 000, et celui des femmes de 1 400 à 600.
Les exilés, notamment en Turquie, au Pakistan et aux États-Unis, vivent dans une extrême précarité et sous la menace d’un retour forcé. HRW appelle les pays d’accueil à respecter le principe de non-refoulement, à soutenir les journalistes afghans réfugiés et à refuser toute reconnaissance d’un régime qui réduit la presse au silence. “Alors que la répression s’intensifie, les voix indépendantes de l’Afghanistan sont plus nécessaires que jamais.” Lire le rapport complet
Suzanne Wrack – 23 octobre 2025
Les Émirats arabes unis ont rejeté les demandes de visa des membres de l’équipe féminine réfugiée d’Afghanistan, qui devait participer à ses premiers matchs officiels dans le pays. Les joueuses, qui s’étaient rendues dans différents aéroports, ont été informées qu’elles ne pouvaient pas embarquer, provoquant chez beaucoup d’entre elles un profond sentiment de traumatisme et de reviviscence. L’équipe devait affronter les Émirats, le Tchad et la Libye dans le cadre de la série Fifa Unites: Women’s Series, du jeudi au mercredi suivant. Les 23 joueuses, sélectionnées lors de camps de détection pour représenter Afghan Women United, devaient s’envoler vers Dubaï le 11 octobre pour un stage d’entraînement. Basées en Australie, au Royaume-Uni, au Portugal et en Italie, elles avaient reçu pour instruction de la FIFA de se rendre à l’aéroport, bien que leurs visas n’aient pas encore été délivrés. Arrivées sur place, la FIFA leur a finalement indiqué qu’elles ne pouvaient pas embarquer. Beaucoup d’entre elles avaient fui l’Afghanistan en 2021 dans des conditions extrêmes, via l’aéroport de Kaboul, lors du retrait des forces occidentales. Depuis, elles vivaient dans l’incertitude, prêtes à voyager à tout moment. Lundi, la FIFA a annoncé que le tournoi serait déplacé au Maroc, la Tunisie remplaçant les Émirats pour compléter le quatuor. Le premier match, impliquant l’équipe afghane, est prévu pour dimanche. La FIFA précise que la responsabilité des visas incombe à la fédération hôte et affirme avoir demandé des garanties avant d’attribuer le tournoi aux Émirats. Les joueuses, épuisées mentalement et physiquement après plus de 30 heures de voyage pour certaines, se disent déçues par l’organisation et inquiètes de devoir jouer si vite après leur arrivéeLa FIFA a reconnu que ces circonstances, indépendantes de sa volonté, ont pu affecter les joueuses, et affirme maintenir leur bien-être comme priorité absolue, en leur offrant un accompagnement psychologique et logistique continu. Les Émirats arabes unis, qui entretiennent des relations de facto avec le gouvernement taliban, n’ont pas commenté la situation. Selon la FIFA, le changement de lieu a été décidé afin de garantir « un environnement sûr, inclusif et compétitif, conforme aux valeurs du tournoi et à la stratégie pionnière de la FIFA en faveur du football féminin afghan ». 22 octobre : La FIFA a annoncé que l’équipe nationale afghane de football féminin en exil a été transférée au Maroc pour participer au tournoi international « FIFA Unites: Women’s Series 2025 ». Selon The New Arab, qui a rapporté tôt jeudi 23 octobre, le tournoi devait initialement avoir lieu à Dubaï à partir de jeudi. Cependant, en raison de problèmes de délivrance de visas pour les joueurs afghans en exil, le lieu et les dates ont été changés, et les matchs commenceront maintenant dimanche. L’équipe féminine afghane en exil se mesurera aux équipes nationales du Tchad, de la Tunisie et de la Libye dans ce tournoi. Les joueuses, qui ont fui l’Afghanistan et résident maintenant dans divers pays, ont nommé leur équipe « Afghan Women United » La FIFA a déclaré dans un communiqué que ce tournoi fait partie de sa « Stratégie d’action globale pour le football féminin afghan », qui comprend la fourniture d’un soutien et d’une préparation aux joueuses afghanes avant les compétitions. Actuellement, la Tunisie se classe au 96e rang mondial de la FIFA, tandis que le Tchad et la Libye doivent encore être inscrits au classement.
|
|
|

|
L’Allemagne voulait éviter la rupture ; elle a signé sa capitulation. En confiant sans le dire le consulat afghan de Bonn à des représentants talibans, Berlin vient d’offrir au régime islamiste une victoire diplomatique et technologique majeure : l’accès à des données sensibles concernant des milliers d’Afghans réfugiés en Europe. À force de vouloir négocier sans reconnaître, de coopérer sans assumer, Berlin s’est fait prendre à son propre jeu.
Une diplomatie qui parle double
Officiellement, le gouvernement allemand ne reconnaît pas l’Émirat islamique d’Afghanistan. Officieusement, il en applique déjà les décisions. Lorsque le ministère des Affaires étrangères taliban a révoqué le consul légitime, Hamid Nangialay Kabiri, Berlin a considéré cette décision “juridiquement contraignante”. En d’autres termes, l’Allemagne n’a pas reconnu les Talibans — mais elle a exécuté leurs ordres.
|
|
|

|
En Afghanistan, 22,972 « madrasas du Djihad » ont été construites par les talibans entre fin 2021 et mi-2025, financés par les pays du Golfe et destinés aux garçons afghans. Aujourd’hui, il y aurait 85 établissements religieux pour chaque école. Des versions pour les filles les préparent à devenir des mères de futurs djihadistes, dans un pays devenu la plaque tournante de l’extrémisme islamiste.
|
|
|

|
Khalilzad, le parrain américain des talibans
Certains diplomates se présentent comme des médiateurs, mais œuvrent en réalité à la destruction des nations. Zalmay Khalilzad, ancien émissaire de Washington, appartient à cette catégorie. Sous prétexte de “réalisme politique”, il a façonné l’un des plus grands désastres stratégiques du XXIe siècle : le retour au pouvoir d’un régime obscurantiste. Aujourd’hui encore, il s’emploie à rendre les talibans fréquentables — et donc légitimes — sur la scène internationale.
|
|
|

|
par Maxence GEVIN
Depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan, en août 2021, les talibans se sont employés à marginaliser les femmes du pays.
Ces dernières semaines, l’étau s’est encore un peu plus resserré avec la restriction des réseaux sociaux.
Pour mieux comprendre les restrictions extrêmes auxquelles sont confrontées les Afghanes, TF1info a contacté Mursal Sayas, journaliste, militante pour les droits des femmes et autrice de « Qui entendra nos cris ? ».
|
|
|

|
Depuis la chute de la République afghane en août 2021, l’espace politique intérieur a été fermé, la société civile réduite au silence et toute forme d’opposition à la domination talibane étouffée. Pourtant, loin d’être éteinte, la voix afghane s’est déplacée. Elle a quitté Kaboul, Hérat ou Mazar-e-Charif pour renaître à Paris, Londres, Berlin, Toronto, Washington, Doha, Istanbul ou Douchanbé. La diaspora afghane, longtemps perçue comme une communauté dispersée, hétérogène et incapable de s’unir, est devenue l’un des acteurs les plus déterminants de l’avenir du pays. Elle n’est plus seulement une population d’exilés, de réfugiés ou de survivants ; elle est désormais un espace de stratégie, de pensée, de mobilisation et de résistance.
Ce basculement n’est pas uniquement démographique ou émotionnel. Il est structurel. La diaspora détient désormais ce que le pays ne possède plus : la liberté de s’exprimer, la capacité d’agir, les compétences techniques, les réseaux diplomatiques, les ressources économiques et l’accès aux institutions internationales. Elle concentre l’expérience politique de l’ancienne République, l’énergie militante de la société civile, la créativité de la nouvelle génération, la légitimité morale des victimes et la mémoire des luttes passées.
|
|
|

|
Michael Barry est un écrivain américain francophon
|
|
|

|
La nouvelle vidéo d’AQ expose la duperie des Talibans, tandis que le réseau exporte sa doctrine du terrorisme vers le Sahel et les capitales occidentales.
Une Menace Opérationnelle et Idéologique Critique
L’évaluation ponctuelle de la menace terroriste émanant de l’Afghanistan révèle un niveau de risque Critique et en Escalade. Sous le régime de l’Émirat Islamique des Talibans, l’Afghanistan est passé du statut de sanctuaire idéologique latent à celui de plateforme opérationnelle pour le jihadisme transnational et régional. Cette transition est marquée par deux évolutions majeures : la réaffirmation publique et directe du lien « inséparable » entre Al-Qaïda (AQ) et les Talibans 1, et un ordre confidentiel émis par le chef suprême taliban, Mullah Hibatullah, demandant la mobilisation de combattants terroristes étrangers expérimentés contre le Pakistan.1
Les avertissements du Conseil de Sécurité des Nations Unies, soulignant que l’Afghanistan est redevenu un centre mondial du terrorisme 1, sont désormais validés par les acteurs de la menace eux-mêmes et par des preuves d’intégration opérationnelle sophistiquée.
|
|
|

|
Le texte « A 47-Year Arc of Conflict and Abuse: Afghanistan’s Unfinished Reckoning », signé par Hassina Jalal, Zareen et Omar Samad, revient sur la décision du Conseil des droits de l’homme de l’ONU de créer un mécanisme d’enquête indépendant sur les violations des droits humains en Afghanistan. Les auteurs saluent cette avancée, mais dénoncent la limitation du mandat aux seules quatre dernières années, estimant qu’aucune justice durable ne peut être rendue sans remonter à la chaîne de violences qui, depuis 1978, a ravagé le pays sous tous les régimes : communiste, moudjahidine, taliban et occidental.
Ils appellent à une approche globale et impartiale, couvrant l’ensemble des crimes commis depuis le coup d’État de 1978, à la reconnaissance juridique du gender apartheid, et à la participation des survivants et de la diaspora dans la documentation des abus. Leur plaidoyer dépasse la politique : il trace les fondations d’une véritable justice transitionnelle afghane, seule capable de briser le cycle de l’impunité.
|
|
|
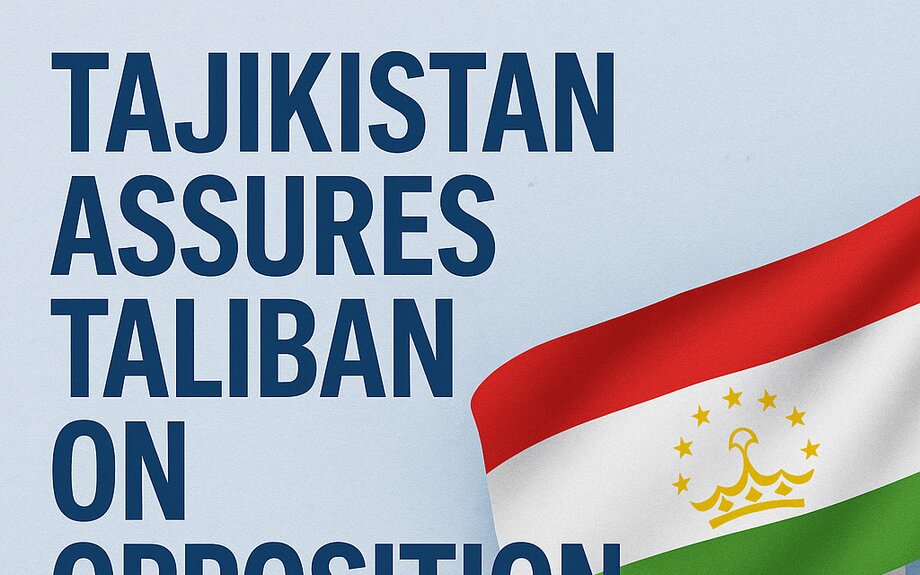
|
Une relation triangulaire entre méfiance, pragmatisme et intérêts stratégiques
Depuis la prise de pouvoir des Taliban en août 2021, la politique du Tadjikistan vis-à-vis de l’Afghanistan s’apparente à un exercice d’équilibriste. D’un côté, Douchanbé incarne depuis longtemps une posture de défi vis-à-vis des Taliban : le régime du président Emomali Rahmon a toujours été un farouche opposant de la première émergence des Taliban à la fin des années 1990, craignant tant leur idéologie que les conséquences sur les minorités tadjikes d’Afghanistan.
|
|
|
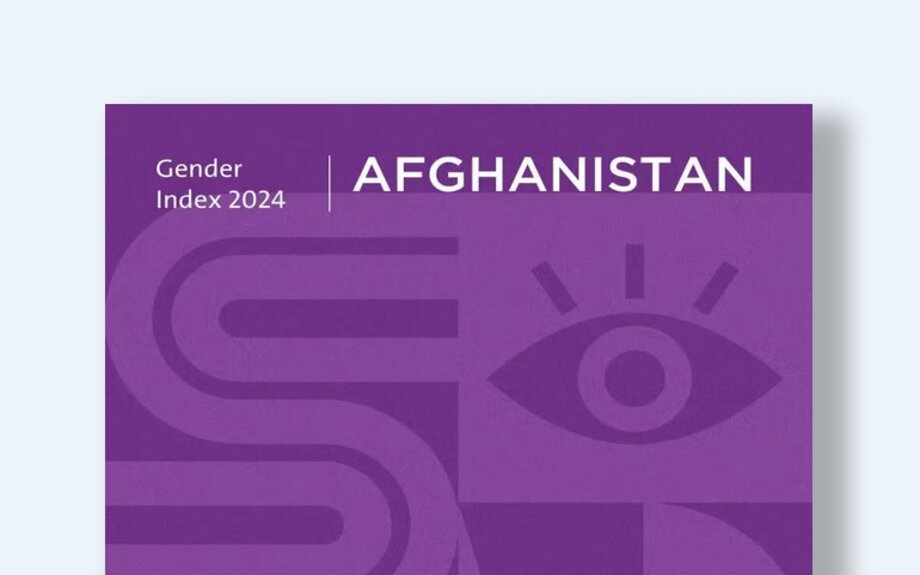
|
Le retour en arrière absolu
Avant 2021, l’Afghanistan figurait déjà dans le bas des classements mondiaux en matière d’égalité de genre. Mais depuis la chute de la République et la prise de pouvoir des Talibans, la situation a basculé dans un régime de régression totale. L’ONU estime que les Afghanes ne peuvent exercer que 17 % de leurs droits et libertés fondamentales, et n’atteignent qu’à peine un quart des résultats masculins dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi ou de la participation politique.
La méthodologie du rapport repose sur les deux indices jumeaux (WEI et GGPI) développés par l’ONU Femmes et le PNUD : ensemble, ils mesurent à la fois la capacité des femmes à exercer leurs droits et la parité réelle entre les sexes. Pour l’Afghanistan, les données ont été collectées entre février et mars 2024 dans huit provinces, auprès de 2 155 personnes. Ce travail de terrain, complété par les données des agences onusiennes, montre un pays où toutes les variables du développement humain sont genrées à la baisse.
|
|
|

|
Par Parwana Ibrahim Khail Nijrabi
En Afghanistan, plus de 20 millions de femmes ont été privées de leurs droits humains et civils les plus fondamentaux sous un régime qui, au nom de l’islam, a imposé certaines des restrictions les plus sévères à l’humanité.
Depuis quatre ans, les talibans imposent une interprétation rigide et autoproclamée de l’islam, transformant le pays en prison pour femmes. Elles sont privées d’éducation, d’emploi, de liberté de mouvement, d’expression publique et même du droit de pratiquer leur culte dans les mosquées.
Au cœur de cet apartheid genré se trouve le mollah Hibatullah Akhundzada, chef suprême des talibans basé à Kandahar. Par une série de décrets misogynes, il prétend que confiner les femmes sous des prétextes religieux apportera la prospérité sociale. En réalité, ses politiques visent à réprimer les femmes et à consolider le pouvoir autoritaire.
|
|
|
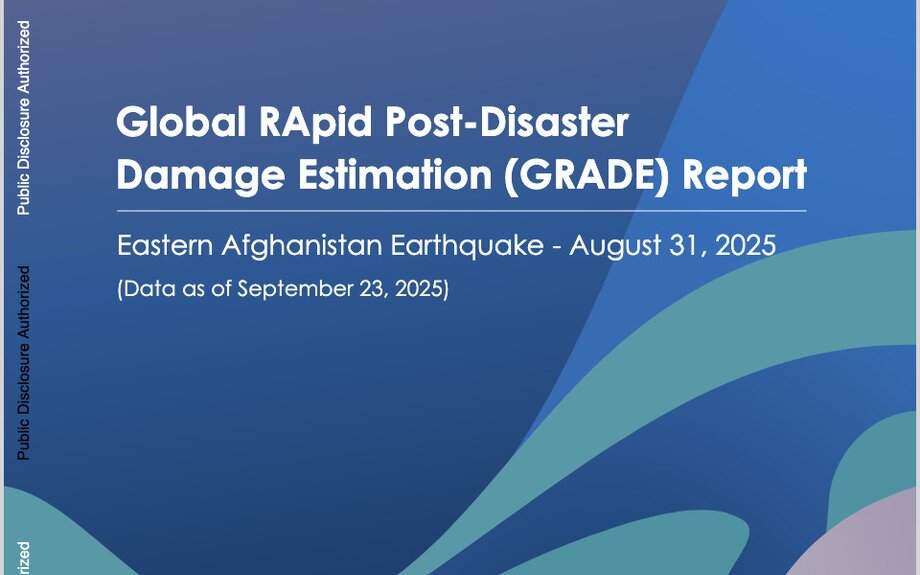
|
Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) – Eastern Afghanistan Earthquake, August 31, 2025
Le 31 août 2025, à 23 h 47, l’Afghanistan s’est à nouveau effondré, littéralement. Un séisme de magnitude 6,0 a frappé les provinces orientales de Kunarha, Nangarhar, Laghman et Noristan, provoquant l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières depuis un quart de siècle. Dans un pays déjà ravagé par la guerre, l’isolement, l’effondrement économique et la répression, la terre elle-même a ajouté son poids à la tragédie. Selon le rapport Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) publié par la Banque mondiale et le Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), le bilan est accablant : près de 2 000 morts, plus de 3 600 blessés et jusqu’à 1,3 million de personnes affectées. Les dégâts matériels sont estimés à 183 millions de dollars, soit plus de 1 % du PIB afghan. C’est un désastre humanitaire, économique et social d’une ampleur considérable — un tremblement de terre au sens propre comme au figuré pour une nation déjà à genoux.
|
|
|

|
Un centre névralgique des données afghanes
Le consulat de Bonn revêt une importance particulière : avant la chute de la République, il abritait le principal centre d’impression et de gestion des passeports afghans en Europe. Des serveurs y stockaient les bases de données de plusieurs missions diplomatiques afghanes situées en Europe, au Canada et en Australie, contenant des millions de documents administratifs et de dossiers personnels. Si les Talibans ont pu accéder à ces serveurs, cela mettrait en danger les opposants politiques réfugiés à l’étranger et leurs familles restées en Afghanistan, exposées à des représailles.
|
|
|

|
Dans cette interview, Fereshta Abbasi affirme que la situation en Afghanistan sous le régime des talibans est bien pire que ce qui se reflète dans les médias. Selon elle, les femmes, les journalistes, les minorités ethniques et religieuses, et tous ceux qui ne partagent pas l’idéologie des talibans vivent dans des conditions profondément répressives et désastreuses. Elle souligne que de nombreux cas de violations des droits de l’homme n’atteignent jamais les médias, et ce qui est rapporté ne représente que la partie émergée de l’iceberg, tandis que l’ampleur de la tragédie est beaucoup plus large et plus alarmante.
|
|
|

|
Réfugiée en France après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan et très engagée en faveur des droits des femmes, la footballeuse Shabnam Salahshoor est la nouvelle lauréate du Grand Prix de l’inclusion par le sport L’Équipe avec la Matmut 2025.
|
|
|

|
Par Muzhda Mohammadi
À l’occasion du quatrième anniversaire de la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans, des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré deux femmes affichant des slogans sur les murs de Kaboul en farsi et en anglais, qualifiant ce jour de « jour sombre pour l’Afghanistan » et présentant leurs « condoléances pour la liberté enchaînée ».
Ils prenaient un risque énorme. Au cours des quatre dernières années, les talibans ont brutalement réprimé les manifestations de rue non violentes, recourant aux arrestations, à la torture et aux mauvais traitements. Selon Richard Bennett, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme en Afghanistan, des détenus ont été victimes d’agressions sexuelles et de violences.
|
|
|

|
Par Nigara Mirdad – Conseillère politique, Ambassade d’Afghanistan à Varsovie
(Publié le 21 octobre 2025 par Sonny Batrouni, rédacteur en chef de Prognoznews.co.uk)
Un nouveau chapitre du paysage politique afghan s’est ouvert après août 2021. L’ascension impitoyable des Talibans au pouvoir a bouleversé de manière irréversible la scène politique du pays et modifié l’équilibre des forces, tant au niveau régional que mondial.
Cette étude examine minutieusement les politiques des Talibans à travers le prisme des réalités de terrain, de leurs ambitions géopolitiques et de leurs engagements internationaux, afin d’offrir une vision sans fard de la situation actuelle de l’Afghanistan. Après avoir pris le pouvoir par la force militaire, les Talibans ont centralisé l’autorité au sein du Conseil de direction de Kandahar. La sécurité s’est considérablement dégradée, malgré la fin des grandes offensives et une certaine stabilité apparente dans quelques villes.
|
|
|

|
Par Hasina Jalal
Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sous le slogan « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », les femmes et les filles afghanes restent tragiquement absentes de cette promesse d’inclusion et de justice. Sous le régime actuel en Afghanistan, elles sont privées d’éducation secondaire et supérieure, interdites de travailler dans la plupart des secteurs, exclues de la vie publique et privées d’accès aux soins de santé et aux espaces communautaires. Leur liberté de mouvement, de réunion et d’expression est strictement restreinte par un régime qui a institutionnalisé l’oppression fondée sur le genre — un système qui soumet les femmes et les filles uniquement en raison de leur sexe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|

