Lorsqu’un régime totalitaire coupe son peuple du monde, il ne s’agit jamais d’un simple choix technique ou de gestion. C’est une arme de domination, une méthode de contrôle, et souvent, un prélude au meurtre de masse. L’Afghanistan vient d’en faire l’expérience, lorsqu’à la fin septembre 2024, les Talibans ont plongé le pays dans un blackout numérique total. En quelques heures, le pays s’est retrouvé isolé : plus d’accès aux cours en ligne pour les filles bannies des écoles, plus de transferts financiers pour les familles déjà asphyxiées, plus de communications pour les journalistes, plus de vols assurés à l’aéroport, plus de coordination pour l’aide humanitaire. Un pays déjà meurtri s’est vu amputé de son dernier souffle de connexion au monde.
Cette décision ne relève pas d’un caprice, mais d’une logique implacable : comme Pol Pot et les Khmers rouges hier, les Talibans aujourd’hui veulent domestiquer un peuple par l’isolement, l’ignorance et la peur. Les Khmers rouges, entre 1975 et 1979, avaient vidé les villes, fermé les écoles, aboli l’argent, et décrété le retour à « l’année zéro ». Le savoir était considéré comme un poison, l’éducation comme un crime. Les intellectuels, les enseignants, les médecins, tous étaient pourchassés et souvent exécutés. La cruauté n’était pas accessoire : elle constituait le socle d’un projet politique où la mort était utilisée comme instrument de purification. Résultat : près de deux millions de morts, soit plus d’un cinquième de la population cambodgienne, massacrés, affamés ou réduits en esclavage.
Les Talibans, eux, n’ont pas vidé les villes. Mais ils ont vidé les écoles de leurs filles, les universités de leurs étudiantes, les administrations de leurs fonctionnaires qualifiés, et les hôpitaux de leurs soignantes. En 2023, plus de 5 000 écoles communautaires ont été fermées, remplacées par des madrasas où l’endoctrinement prime sur l’instruction. Les enseignantes ont été écartées, humiliées, bannies. Les étudiantes exclues des campus. Les journalistes réduits au silence. Comme les Khmers rouges hier, les Talibans aujourd’hui ont identifié leur ennemi : le savoir, l’esprit critique, l’indépendance. Éradiquer l’éducation, c’est détruire les capacités de résistance d’un peuple.
La cruauté, chez les uns comme chez les autres, n’est jamais accidentelle. Elle est systémique. Les Khmers rouges enfermaient leurs victimes dans les prisons de Tuol Sleng, où la torture précède l’exécution dans les Killing Fields. Les Talibans enferment leurs femmes chez elles, les flagellent en public, les enlèvent par dizaines dans les rues de Kaboul. Là où Pol Pot voyait dans les lunettes le signe d’un intellectuel à éliminer, les Talibans voient dans les cheveux découverts ou le rire d’une femme une provocation à châtier. Dans les deux cas, la violence est idéologique : détruire l’individu pour remodeler la société selon un dogme exclusif.
Mais il existe une autre ressemblance, plus mortelle encore : l’isolement comme stratégie. Les Khmers rouges avaient coupé le Cambodge du monde, persuadés de pouvoir bâtir leur utopie autarcique. Les Talibans, eux, jouent un double jeu : ils recherchent une reconnaissance internationale tout en coupant leur peuple de toute voix libre et de tout lien vital. Le blackout numérique en est la démonstration la plus cynique. Dans un pays frappé par des tremblements de terre, où les infrastructures hospitalières s’écroulent, où neuf millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire sévère, couper Internet, c’est interdire l’arrivée des secours. Les ONG ne peuvent plus coordonner leurs interventions. Les convois humanitaires se perdent. Les hôpitaux, déjà privés de médecins femmes, ne reçoivent plus les médicaments ni les équipements nécessaires. Les victimes s’entassent dans les ruines, sans contact, sans espoir. C’est une cruauté à distance, une mort lente organisée par la privation de moyens de survie.
Le parallèle avec le Cambodge n’est pas une métaphore exagérée. En trois ans de règne, les Khmers rouges ont provoqué l’anéantissement d’un cinquième de leur population. Rapporté à l’Afghanistan actuel, cela représenterait près de huit millions de morts. Les conditions sont réunies : famine, absence de soins, catastrophes naturelles non secourues, exécutions arbitraires, disparitions. Les Talibans ont déjà ciblé certaines communautés pour les affaiblir : les femmes libres, les Hazaras, les intellectuels, les journalistes, les anciens soldats. Chaque catégorie devient une victime désignée, un « corps de trop » que le régime accepte de sacrifier.
Cette politique n’est pas seulement une dictature : elle s’apparente à un effacement programmé. Le silence imposé par la coupure d’Internet n’est qu’un outil de plus pour transformer le pays en prison à ciel ouvert. Comme les Khmers rouges, les Talibans placent l’idéologie au-dessus de l’humain. Comme eux, ils préfèrent voir des milliers mourir plutôt que d’admettre la nécessité du savoir, de la solidarité et du monde extérieur.
La cruauté, dans ces régimes, n’est pas une dérive : elle est une méthode. Pol Pot l’avait compris, et Hibatullah Akhundzada le met en œuvre : un peuple terrorisé est un peuple docile. Mais un peuple coupé du monde est un peuple condamné.
L’histoire a déjà tranché. Le Cambodge des Khmers rouges fut reconnu comme un génocide. Pour l’Afghanistan, le mot n’est pas encore prononcé. Mais il faudra bien un jour l’affronter : les Talibans mènent un massacre au ralenti, et chaque coupure d’Internet, chaque interdiction scolaire, chaque hôpital vidé de ses soignants rapproche le pays de l’abîme.
Silence numérique, silence des secours, silence des victimes : tout se répète. Et si le monde détourne le regard, l’Afghanistan connaîtra, comme le Cambodge, la même fin : des centaines de milliers de morts, abandonnés au nom d’une idéologie meurtrière.
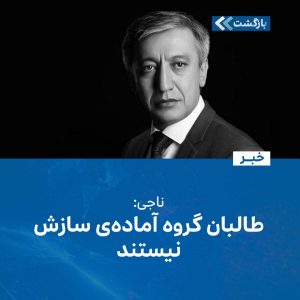
La réactivation d’internet sur ordre du Premier ministre taliban montre une fissure dans le régime d’Hibatullah
Dawood Naji, président du comité politique du Front de libération de l’Afghanistan, a réagi à la réactivation d’internet dans le pays, déclarant que cette décision a été prise sur ordre du Premier ministre taliban à Kaboul.
Naji a écrit ce mercredi 9 Mehr (Mizan) dans un message sur le réseau X que cette action va à l’encontre du décret d’Hibatullah Akhundzada, le chef de ce groupe à Kandahar.
Il a écrit : « C’est la première fois que Kaboul considère comme licite l’ordre interdit d’Hibatullah et agit en opposition à Kandahar. Cela montre la première fissure dans la structure du régime d’Hibatullah. »
Hibatullah Akhundzada, le chef secret des talibans, avait auparavant déclaré oralement que les personnes s’opposant à la coupure d’internet sont des criminels.
L’Afghanistan a connu une coupure totale d’internet pendant deux jours, ce qui a affecté la vie quotidienne des gens, les activités économiques et le travail des organisations humanitaires.
Des sources ont confirmé auparavant que dans plusieurs provinces, internet a été rétabli, mais les restrictions persistent et la vitesse d’internet reste faible.




