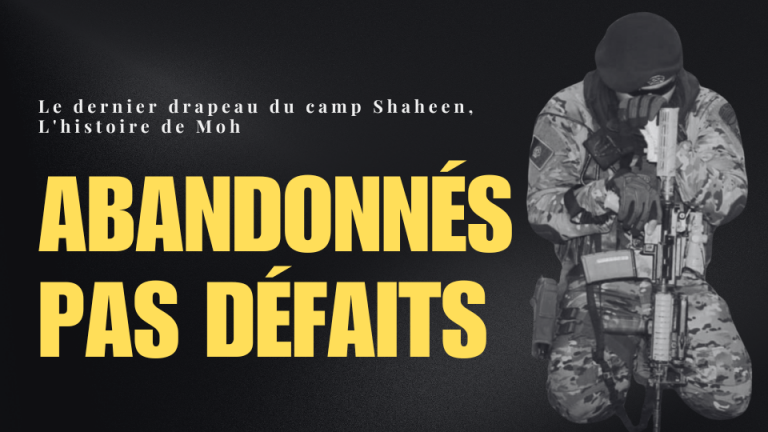La scène se répète, implacable : des familles afghanes entières, parfois installées en Iran depuis des années, sont brutalement expulsées sans préavis, sans procédure, sans recours. Les images qui nous parviennent des provinces frontalières de l’ouest de l’Afghanistan rappellent davantage les déportations de populations qu’une quelconque gestion ordonnée des flux migratoires. Hommes, femmes, enfants, malades, étudiants, jeunes filles seules : tous sont livrés au désert. Livrés, surtout, à un avenir de plus en plus condamné.
La députée européenne Hannah Neumann a été l’une des rares voix à s’indigner publiquement de ce que l’Iran orchestre, avec le silence coupable de la communauté internationale. Dans une déclaration ferme, elle a dénoncé une « expulsion massive, illégale, sans procédure légale » et qualifié ces retours forcés d’« échec collectif ». Ce que l’on appelle pudiquement une crise migratoire est en réalité une entreprise de déshumanisation systématique. Les renvois vers l’Afghanistan ne sont pas des simples déplacements administratifs : ils renvoient des femmes vers un système qui les nie, des enfants vers la faim, et des hommes vers la répression ou le recrutement forcé.
Une politique d’État brutale et cynique
Les propos de Hannah Neumann sont sans détour : ce n’est pas le chaos qui gouverne cette situation, mais une « politique d’État délibérée ». L’Iran, signataire des conventions internationales sur les réfugiés, choisit de violer ces engagements au nom d’intérêts sécuritaires, économiques et politiques. Les expulsions massives sont parfois accompagnées de violences policières, de confiscations de papiers ou d’argent, et d’arrestations arbitraires. Même les détenteurs de visas ou les étudiants ne sont pas épargnés.
Cette déportation silencieuse, qui touche des centaines de milliers de réfugiés afghans chaque mois, n’est que le dernier chapitre d’un abandon programmé par l’Occident. Car il faut rappeler que, dès 2021, l’Union européenne avait officiellement encouragé les réfugiés afghans à chercher protection dans les pays voisins. L’Iran faisait alors figure d’option préférable, en comparaison avec les risques d’un exil maritime ou clandestin vers l’Europe. Trois ans plus tard, ces choix apparaissent non seulement illusoires, mais tragiquement irresponsables.
Une poudrière migratoire aux portes de l’Europe
Ce qui se joue actuellement sur la frontière afghano-iranienne est loin d’être un simple drame humanitaire. Il s’agit d’un accélérateur de crise migratoire à très court terme. L’Iran, en multipliant les expulsions, déverse vers l’Afghanistan une population vulnérable, désespérée et sans avenir. Les conditions de vie en Afghanistan, sous l’autorité des talibans, sont devenues proprement intenables. Une fois refoulés dans leur pays, les réfugiés n’ont d’autre choix que de repartir — cette fois vers l’Europe, par les routes les plus périlleuses, au prix de trafics, de violences, de disparitions.
La France, l’Allemagne, l’Autriche, mais aussi la Grèce, l’Italie et les Balkans, se retrouveront en première ligne d’un nouveau déferlement de réfugiés, bien plus massif encore que celui de 2015. Car il ne s’agit plus seulement d’individus fuyant la guerre : il s’agit d’une population entière rendue étrangère à tous les territoires, y compris le sien. Faute de couloirs humanitaires sûrs, ce sont les réseaux mafieux, les trafiquants d’êtres humains, les groupes djihadistes qui prendront le relais.
La tentation d’instrumentaliser les anciens commandos
Un autre risque se profile, plus discret, mais non moins explosif : celui de la récupération des anciens commandos de l’armée afghane, réfugiés eux aussi en Iran. Nombre d’entre eux ont été formés par les forces spéciales américaines ou britanniques, aguerris, disciplinés, bilingues, et en situation d’extrême précarité. Des enquêtes récentes (notamment le rapport MEMRI n°11733) ont révélé que la Russie avait commencé à recruter ces anciens militaires afghans en exil, leur offrant des salaires mensuels pour aller combattre en Ukraine contre les forces occidentales. Cette pratique, amorcée dès 2023 avec la dissolution de Wagner, s’est poursuivie de manière plus souterraine via des réseaux de sous-traitants militaires russes ou iraniens.
Le scénario est glaçant : des hommes formés par l’Occident, trahis puis abandonnés, sont récupérés par ses ennemis pour devenir des mercenaires contre leurs anciens alliés. Outre le cynisme de cette dynamique, elle révèle l’aveuglement stratégique de l’Europe. En ne proposant aucun exutoire politique ou militaire à ces anciens soldats — souvent patriotes et désireux de lutter pour un Afghanistan libre —, on les pousse à vendre leur expertise au plus offrant.
Soutenir les résistances afghanes : une urgence stratégique
Face à cette spirale, il est temps d’inverser le raisonnement : plutôt que de subir les flux migratoires ou de craindre les alliances toxiques de nos anciens partenaires, pourquoi ne pas leur offrir un horizon politique et militaire ? Les résistances afghanes existent : qu’elles soient féminines, civiles, intellectuelles, ou armées. Elles réclament un soutien, une légitimité, une visibilité. Il n’est pas trop tard pour structurer une politique européenne de soutien à une opposition afghane crédible, pluraliste, fédérée.
Les femmes afghanes qui manifestent à visage découvert à Kaboul, les journalistes qui résistent à la censure depuis l’exil, les fronts armés comme la NRF (Front national de résistance), l’AFF (Afghanistan Freedom Front) ou l’ALM (Afghanistan Liberation Movement), tous ont besoin d’alliés. Offrir à ces forces une reconnaissance politique, une aide matérielle et une plate-forme médiatique serait bien plus utile que de dépenser des milliards à contenir des vagues migratoires impossibles à stopper. Ce serait aussi redonner un sens aux valeurs européennes : droit des femmes, liberté de conscience, lutte contre l’extrémisme.
Construire une alternative plutôt que des murs
La proposition de la députée Hannah Neumann d’ouvrir des voies de visa humanitaire ciblées pour les réfugiés afghans en Iran ne relève pas d’un idéalisme naïf, mais d’une stratégie de responsabilité maîtrisée. Il ne s’agit pas d’ouvrir les frontières sans discernement, mais d’opérer un accueil sélectif et prioritaire : identifier les profils à haut risque ou à haute valeur démocratique — femmes militantes, enseignants, journalistes, anciens soldats de la République — et leur offrir un refuge temporaire et surtout un appui logistique et politique. Ce geste, limité en volume mais fort en symboles, permettrait à l’Europe d’incarner ses valeurs sans compromettre sa stabilité. Et surtout, il permettrait à ces exilés de devenir, demain, les piliers d’une alternative afghane crédible, capables de porter une voix politique, éducative ou militaire face à la dictature talibane.
Plutôt que d’attendre, impuissants, l’effondrement de toutes les digues migratoires, les États européens devraient considérer l’investissement dans les résistances afghanes comme un levier d’action géopolitique. Il ne s’agit pas de reconstruire un État afghan à distance, mais de soutenir celles et ceux qui, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, incarnent un projet de société opposé à celui des talibans. Une société ouverte, pluraliste, respectueuse des droits.
Un choix de civilisation
Le dilemme posé à l’Europe n’est pas technique, il est moral et civilisationnel. Ou bien nous choisissons de fermer les yeux, en espérant que les murs et les camps suffiront à endiguer les flux. Ou bien nous prenons acte que ce qui se passe en Iran et en Afghanistan est déjà en train de produire ses effets sur nos frontières, nos débats publics, nos équilibres sociaux. La guerre n’est jamais loin. Elle s’infiltre dans nos sociétés par le biais de ces tragédies exilées.
Soutenir la jeunesse afghane, les femmes insurgées, les ex-militaires abandonnés et la résistance politique, ce n’est pas du romantisme. C’est de la prévoyance. C’est choisir de faire de l’Afghanistan un front de résistance à l’obscurantisme, plutôt qu’un réservoir de drames à venir.