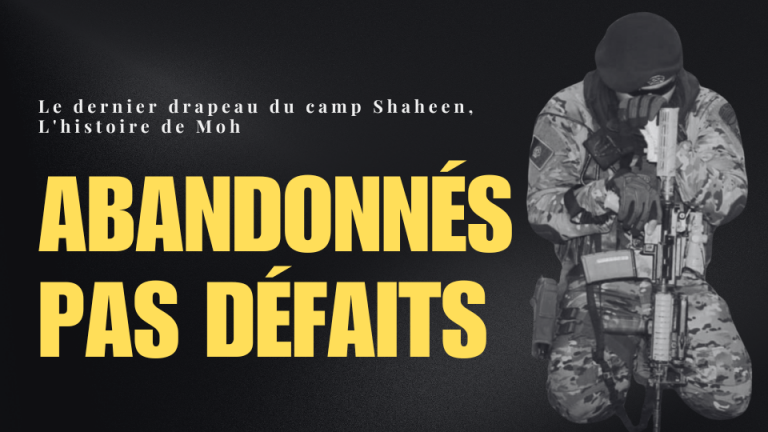Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle : la base aérienne de Bagram, ancien cœur battant de la présence militaire américaine en Afghanistan, serait désormais investie par la Chine. À l’origine de cette allégation, Ali Maisam Nazary, porte-parole du Front national de résistance (NRF), évoque des « rapports crédibles » faisant état d’une présence chinoise sur place, rendue possible par la complicité des Talibans. L’accusation, si elle n’est pas étayée par des preuves irréfutables, a toutefois valeur de signal d’alarme.
Car au-delà de la véracité immédiate des faits, une inquiétude plus profonde se fait jour : les Talibans contrôlent-ils vraiment le territoire afghan ? Ont-ils encore une quelconque maîtrise des leviers de souveraineté nationale ? Ou bien leur pouvoir n’est-il qu’une façade, masquant la fragmentation du pays, livré aux intérêts de puissances étrangères ?
Le cas de Bagram concentre toutes ces interrogations. Hautement symbolique, la base fut d’abord un bastion soviétique, puis le pivot des opérations américaines et de l’OTAN pendant deux décennies. Sa situation géographique, sa double piste capable d’accueillir des avions lourds, ses installations logistiques en font un atout stratégique de premier ordre. Qu’une puissance étrangère — aujourd’hui la Chine, demain peut-être une autre — puisse y installer discrètement ses appareils, militaires ou civils, devrait alerter toute conscience afghane.
Certes, les Talibans démentent catégoriquement. Leurs porte-parole répètent que l’Afghanistan est indépendant, que « jamais » ils ne remettraient une parcelle du territoire national à une puissance étrangère. Mais les mêmes Talibans ont déjà cédé des pans entiers de la souveraineté économique à des acteurs extérieurs, notamment dans les secteurs minier et énergétique. Leur dépendance aux financements qatariens, pakistanais ou chinois est documentée. Leur silence sur certaines ingérences régionales aussi.
Alors, si l’affaire Bagram n’est pas confirmée, elle reste plausible. Et c’est cette plausibilité qui est inquiétante.
Car ce qu’elle révèle, c’est la perte progressive de la maîtrise du territoire par les Talibans eux-mêmes. Pris dans leurs contradictions, affaiblis par les rivalités internes, incapables de gouverner autrement que par la peur et la répression, ils ne sont plus en mesure d’empêcher que d’autres forces, plus structurées, plus patientes, ne prennent pied durablement en Afghanistan. La Chine, qui avance toujours sans bruit, mais avec constance, pourrait bien transformer l’ancien centre de commandement américain en base logistique pour ses propres intérêts : surveillance des groupes ouïghours, sécurisation de ses routes économiques, accès privilégié aux minerais afghans.
Si tel était le cas, ce serait un véritable scandale. Non pas seulement pour ce que cela dit des Talibans, mais pour ce que cela signifierait pour l’Afghanistan tout entier : après l’occupation soviétique, puis l’ingérence américaine, le pays deviendrait, une fois de plus, un simple pion sur l’échiquier mondial. Un territoire disponible, sans État légitime, sans armée nationale, sans voix souveraine.
C’est à cela que doivent réfléchir aujourd’hui les Afghans, qu’ils soient en exil ou sur leur sol. À défaut d’un pouvoir démocratique, à défaut d’une opposition unifiée, c’est la voix du peuple qu’il faut réveiller. Car si demain la base de Bagram devient le relais discret d’une autre hégémonie, ce n’est pas seulement une question de diplomatie. C’est une question de dignité nationale.
L’ombre de la Chine sur l’Afghanistan : investissements, minerais et domination silencieuse
Depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, la Chine s’impose progressivement comme l’un des acteurs économiques majeurs du nouveau paysage afghan. Sans avoir reconnu officiellement le régime taliban, Pékin avance à pas feutrés mais sûrs, à travers une stratégie mêlant diplomatie, économie extractive, projets logistiques et accords bilatéraux. Le pays semble devenu pour la Chine une pièce centrale de ses ambitions régionales, à la croisée de la Belt and Road Initiative (BRI) et de la sécurisation de ses propres frontières.
Des milliards dans le sol : le pari minier de Pékin
Le secteur le plus convoité reste sans conteste le secteur minier. En septembre 2023, le régime taliban a annoncé avoir signé sept nouveaux contrats miniers pour un montant cumulé de 6,5 milliards de dollars. Ces accords portent sur l’exploitation de l’or, du cuivre, du zinc, du plomb et du fer, dans des provinces stratégiques telles que Takhar, Ghor, Herat ou encore Logar. Si plusieurs sociétés afghanes ou régionales figurent dans ces contrats, de nombreuses entreprises chinoises sont partie prenante ou partenaires techniques.
L’un des projets les plus emblématiques, mais aussi les plus controversés, est celui de la mine de cuivre de Mes Aynak, située dans la province de Logar. Conclu dès 2008 avec la société China Metallurgical Group Corporation (MCC), ce contrat avait été gelé durant des années pour des raisons sécuritaires et de corruption. Il a été relancé récemment sous les Talibans, malgré l’opacité persistante de ses termes. Mes Aynak n’est pas seulement l’un des plus grands gisements de cuivre du monde : le site est aussi un patrimoine archéologique majeur, que les projets d’exploitation menacent de détruire définitivement. Mais dans le contexte actuel, les Talibans privilégient la rentabilité immédiate à la préservation historique.
Les chiffres donnent le tournis. Depuis août 2021, plus de 200 contrats miniers auraient été signés, impliquant au moins 150 entreprises, selon les investigations croisées d’Afghan Witness, Info-Res et plusieurs think tanks. Si une partie de ces contrats est purement spéculative, ils tracent les contours d’un Afghanistan livré à l’extraction massive de ses ressources, dans des conditions de contrôle, de transparence et de souveraineté très discutables.
Le pétrole aussi, malgré les revers
La stratégie chinoise ne se limite pas aux métaux. En janvier 2023, un contrat pétrolier de grande ampleur a été signé entre les Talibans et l’entreprise chinoise CAPEIC (Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co.). Le projet prévoyait l’exploitation du bassin pétrolifère d’Amou Darya, au nord du pays, avec un investissement annoncé de 540 millions de dollars sur trois ans. Ce contrat, censé durer jusqu’en 2048, incluait également la construction d’une raffinerie en Afghanistan. Les Talibans avaient promis une redevance de 15 % sur la production au profit de l’État.
Mais en juin 2025, coup de théâtre : le contrat est annulé par les Talibans eux-mêmes, pour « manquements contractuels » du partenaire chinois. Si les détails ne sont pas publics, cette annulation souligne deux choses : d’une part, l’extrême fragilité juridique des contrats signés par le régime, et d’autre part, la difficulté qu’éprouve la Chine à opérer dans un environnement aussi instable.
Routes, douanes et corridors économiques : l’intégration afghane dans la sphère chinoise
La coopération entre les Talibans et la Chine dépasse le simple cadre de l’extraction. En décembre 2024, un accord de libre-échange partiel a été signé, permettant à 98 % des produits afghans d’entrer sur le marché chinois sans droits de douane. Les principaux bénéficiaires de cet accord sont les secteurs agricoles et miniers. Côté logistique, des projets d’infrastructure ont été annoncés : construction de corridors commerciaux, liaison aérienne régulière entre Kaboul et Urumqi, déploiement de la fibre optique, notamment en lien avec la Chine et le Pakistan.
Ces initiatives s’inscrivent dans une logique plus vaste : intégrer l’Afghanistan au projet d’expansion économique chinois qu’est la Belt and Road Initiative. Cela passe par une connexion plus étroite avec le CPEC (China–Pakistan Economic Corridor), via la route du Wakhan ou de Badakhshan, deux axes aujourd’hui sous contrôle des Talibans.
Une présence sans reconnaissance : la stratégie de Pékin
Pékin se garde bien de reconnaître officiellement le régime taliban. Pourtant, la Chine est aujourd’hui l’un des seuls pays à entretenir une ambassade active à Kaboul. Elle a également multiplié les contacts bilatéraux, les aides humanitaires ponctuelles et les visites discrètes. L’objectif n’est pas de soutenir idéologiquement les Talibans, mais de stabiliser la région, notamment pour empêcher tout activisme islamiste dans le Xinjiang voisin, et de sécuriser ses intérêts économiques.
La prudence est cependant de mise. La Chine n’investit massivement qu’en terrain maîtrisé. Les projets concrets restent limités, les annonces souvent prématurées. Pékin ne veut pas reproduire les erreurs occidentales : elle n’envoie pas de troupes, ne finance pas de programmes de gouvernance, et agit surtout par l’intermédiaire d’entreprises d’État, à la fois souples et contrôlées.
Vers une domination économique sans contrôle local ?
La principale conséquence de ces accords est l’effacement progressif de toute souveraineté économique afghane. Les Talibans, en quête désespérée de revenus et de reconnaissance, cèdent des pans entiers de leur sous-sol à des entreprises étrangères, sans capacité technique ni administrative à surveiller ou réguler ces activités. Les bénéfices à court terme masquent mal une forme de dépossession stratégique : l’Afghanistan, au lieu de bâtir un modèle de développement autonome, devient un gisement à ciel ouvert au profit d’intérêts extérieurs.
Les promesses d’emplois locaux, de développement des infrastructures ou de partage équitable sont rarement tenues. L’opacité règne, les populations locales ne sont pas consultées, et les voix critiques sont muselées. L’accès aux sites miniers est souvent militarisé, surveillé, voire sous contrôle d’unités talibanes liées aux réseaux de contrebande ou à des groupes étrangers.
Une dépendance déguisée
L’Afghanistan d’aujourd’hui est en train de passer d’une dépendance à l’aide occidentale à une dépendance à l’extraction étrangère. La Chine, sans être seule, y joue un rôle de plus en plus central. Le scandale ne réside pas seulement dans la nature des accords passés, mais dans l’incapacité des Talibans à défendre les intérêts du pays qu’ils prétendent diriger. Le peuple afghan, exclu de toute négociation, voit son avenir se jouer entre grandes puissances, sans contrôle, sans débat, sans recours.