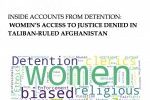La talibanisation du vide
Depuis trois ans, les Talibans gouvernent un pays qu’ils ne savent ni administrer, ni financer, ni faire vivre. Leur victoire militaire s’est muée en impasse politique. L’émirat qu’ils ont rétabli repose sur une illusion : celle qu’un pouvoir religieux, armé et fermé sur lui-même pourrait diriger un État moderne sans compétences, sans partenaires et sans peuple libre. À mesure que le temps passe, cette illusion se fissure. Ce n’est plus un régime qui gouverne, mais un vide qui s’étend — un vide institutionnel, économique et humain.
L’illusion de la stabilité
Les Talibans ont voulu se présenter comme les garants d’un ordre retrouvé, après vingt ans de guerre et de corruption. Ils ont fait croire à une forme de stabilité : plus de combats ouverts, des routes à nouveau sûres pour les convois, un État sans contestation apparente. Mais cette stabilité n’est qu’un trompe-l’œil. L’absence de conflit ne signifie pas la paix ; l’absence d’opposition ne signifie pas le consensus. Ce qu’ils appellent « stabilité » n’est que la paralysie d’un pays soumis à la peur. La sécurité est devenue leur unique légitimité, mais même cette carte est en train de brûler : les attaques de l’État islamique, la montée de la criminalité, et les tensions frontalières avec le Pakistan montrent à quel point leur emprise est précaire.
Un État sous perfusion humanitaire
L’Afghanistan vit aujourd’hui sous assistance respiratoire. Ce ne sont ni les ministères talibans ni leurs administrateurs religieux qui nourrissent la population, mais les agences humanitaires : le PAM distribue la farine, l’OMS gère les cliniques, et les ONG locales assurent le minimum vital. Les Talibans prétendent diriger un État souverain, mais ils dépendent d’une aide étrangère qu’ils méprisent idéologiquement et qu’ils exploitent politiquement. C’est un paradoxe : leur survie dépend de la charité internationale, alors même qu’ils rejettent les principes qui la fondent — égalité, inclusion, éducation. Tant que les bailleurs craignent un effondrement total, ils maintiennent ce filet humanitaire. Mais à chaque nouvelle crise mondiale, ce filet se resserre. L’Afghanistan devient une zone grise : ni en guerre, ni en reconstruction, suspendue dans une léthargie que les Talibans appellent « l’ordre islamique ».
La fin des infrastructures
Les vestiges de la République se délitent. Les barrages construits dans les années 2000 s’envasent. Les routes se fissurent. Les hôpitaux manquent de matériel, les écoles d’électricité. Ce délabrement silencieux est plus parlant qu’un rapport d’ONG : il montre l’incapacité structurelle du régime à entretenir ce qu’il n’a pas bâti. La République, avec toutes ses failles, reposait sur un réseau de compétences et de coopérations. L’émirat repose sur des décrets et des sermons. Les ingénieurs, les professeurs, les médecins formés avant 2021 ont fui. Ce ne sont pas seulement des individus qui sont partis, c’est une génération de savoir-faire. Le résultat est implacable : le pays ne se reconstruit pas, il s’érode.
Une économie tournée vers le néant
Sans industrie, sans commerce international, sans fiscalité réelle, les Talibans ont hérité d’un pays ruiné et l’ont transformé en économie de subsistance. Leur politique économique tient en trois mots : taxer, contrôler, interdire. Ils prélèvent des dîmes sur tout ce qui bouge — les routes, les marchés, les carburants, les transferts — mais ne réinvestissent rien. L’économie tourne en rond sur elle-même, enfermée dans un cycle de pauvreté. Le commerce avec les voisins est plombé par l’insécurité et l’instabilité des taux de change. Le peu de devises qui entre vient des ONG, des transferts familiaux ou du narcotrafic. L’État n’a plus de budget de développement, seulement une caisse d’entretien du pouvoir. Dans ces conditions, aucune administration ne peut fonctionner : les salaires sont versés par intermittence, les fonctionnaires démissionnent, les provinces s’autogèrent tant bien que mal.
La fuite des compétences, la fin du savoir
Ce qui manque le plus à l’Afghanistan, ce ne sont pas les armes, mais les cerveaux. L’intelligentsia s’est exilée, la jeunesse qualifiée a fui, les femmes — professeures, médecins, juristes — ont été chassées de la vie publique. L’émirat taliban est une forteresse vide. Il contrôle le territoire, mais pas les connaissances qui font vivre une nation. L’université de Kaboul est devenue un lieu de propagande. Les manuels scolaires sont épurés de toute pensée critique. Les savants religieux dominent les techniciens. En éradiquant le savoir, les Talibans ont détruit la seule ressource que l’Afghanistan possédait encore : son capital humain. Cette saignée intellectuelle est irréversible à court terme. Un État peut importer du blé, pas des enseignants.
Des voisins sans loyauté
La géopolitique n’offre aucun salut. Le Pakistan, jadis parrain et allié, est aujourd’hui leur premier adversaire. L’armée pakistanaise accuse Kaboul de soutenir le TTP (les Talibans pakistanais) et multiplie les menaces. La Chine exploite quelques gisements miniers, mais sans investir dans la population. L’Inde, en rouvrant son ambassade à Kaboul, joue un pari risqué : celui de contenir Islamabad à travers un partenaire instable et idéologiquement dangereux. Quant à la Russie, elle n’a ni les moyens ni l’intérêt d’aider un régime qui n’a rien à offrir en retour. Les pays du Golfe ont tourné la page : ils regardent vers les BRICS, pas vers un émirat en faillite. Aucun voisin ne souhaite voir les Talibans s’effondrer brutalement, mais aucun ne veut non plus les soutenir durablement. Le régime n’a que des relations transactionnelles, pas d’alliances.
La monétisation du crime
Privés de financements institutionnels, les Talibans se sont rabattus sur l’économie illicite. Après avoir prétendu bannir le pavot, ils ont laissé prospérer la méthamphétamine. L’Afghanistan devient le nouveau laboratoire du narco-terrorisme : production chimique, trafic transfrontalier, blanchiment, taxation. Les chefs de guerre talibans, qui dirigent aujourd’hui des provinces, contrôlent ces circuits. La drogue ne sert plus seulement à financer la guerre, mais à maintenir la paix interne : elle nourrit des loyautés. C’est une économie mafieuse d’État. Mais cette rente criminelle a ses limites. Elle isole davantage le pays, expose le régime à des sanctions, et alimente des rivalités de factions. Le crime ne remplace pas la gouvernance. Il la dévore.
Les luttes intestines : un pouvoir qui se dévore lui-même
Derrière la façade d’unité religieuse, le régime taliban est miné par des fractures profondes. Le duel entre Kandahar et Kaboul, entre les religieux fidèles à Hibatullah Akhundzada et les pragmatiques du gouvernement, s’intensifie. Les ministres civils se plaignent de l’ingérence constante des oulémas ; les commandants de terrain contestent les décisions venues de Kandahar ; les chefs de services de renseignement se méfient des alliances tribales. La paranoïa s’installe. Chaque courant tente de s’assurer le contrôle des revenus — qu’ils viennent des douanes, du trafic de drogue ou des taxes locales. Ce sont moins des divisions idéologiques que des guerres d’intérêts. Le mollah Baradar et Sirajuddin Haqqani incarnent deux pôles rivaux : l’un cherche à donner au régime une façade d’État, l’autre veut le transformer en réseau de pouvoir. Entre les deux, Akhundzada verrouille tout, isolé dans son bastion de Kandahar, obsédé par la pureté de la charia. Ces luttes internes sont la maladie chronique du régime : elles l’empêchent de se moderniser et fragilisent son autorité. À mesure que les ressources s’amenuisent, les rivalités s’aiguisent. L’émirat, déjà isolé du monde, se fragmente de l’intérieur.
La décentralisation du chaos
Face à leur impuissance à gouverner de manière centralisée, les Talibans laissent les provinces se gérer. Chaque région se dote de ses propres circuits d’approvisionnement, ses taxes, ses arrangements locaux. Les gouverneurs talibans deviennent des seigneurs féodaux, les communautés locales s’organisent pour survivre. Cette décentralisation de fait crée un équilibre instable : le centre garde la façade du pouvoir religieux, tandis que la périphérie gère le quotidien. C’est ainsi que l’émirat se maintient : non par efficacité, mais par fragmentation. Le pays devient une mosaïque d’autonomies sous bannière unique.
Le prix du refus
Il reste pourtant une issue — mais elle exige ce que les Talibans refusent : l’ouverture. Réintégrer les femmes, réhabiliter l’éducation, rappeler les exilés, accepter un partage du pouvoir, reconnaître la pluralité du pays. En un mot : renoncer à l’absolu pour sauver l’État. Tant qu’ils n’y consentent pas, aucune aide ne suffira, aucun voisin ne les sauvera, aucune diplomatie ne les stabilisera. Leur échec n’est pas une question d’idéologie, mais de pragmatisme. Aucun État ne peut vivre sans intelligence, sans argent et sans horizon.
La certitude du déclin — et la promesse du renouveau
L’Afghanistan est devenu le laboratoire d’un paradoxe : un pays sous contrôle mais sans gouvernance, un territoire occupé par un pouvoir qui n’existe que pour lui-même. Les Talibans administrent l’absence d’avenir. Ils tiennent le pays non par la construction, mais par la peur ; non par la foi, mais par le vide. Tôt ou tard, ce vide se refermera sur eux. L’histoire ne connaît pas de régime qui ait survécu à sa propre stérilité.
Les capitales occidentales aiment à répéter qu’il n’existe « aucune alternative » aux Talibans. C’est une erreur de jugement. Les régimes autoritaires qui résistent possèdent tous une base matérielle ou intellectuelle, éducation, productivité, ressources naturelles, etc , les Talibans, eux, n’ont rien de tout cela, et pas davantage de projet. Leur survie repose sur la peur et le silence, deux matières instables.
Leur effondrement est donc une certitude. La seule inconnue, c’est quand.
Mais ce vide n’est pas définitif. Un autre Afghanistan existe déjà, au-delà de ses frontières : celui de la diaspora, instruite, active, connectée au monde. Tandis que le pays s’enferme, elle continue de penser, d’apprendre et de bâtir. C’est là que se trouve le véritable capital humain du futur. Le jour où le régime tombera, c’est dans cette diaspora que renaîtra la continuité de l’État afghan — non pas par nostalgie, mais par nécessité.
À lire aussi