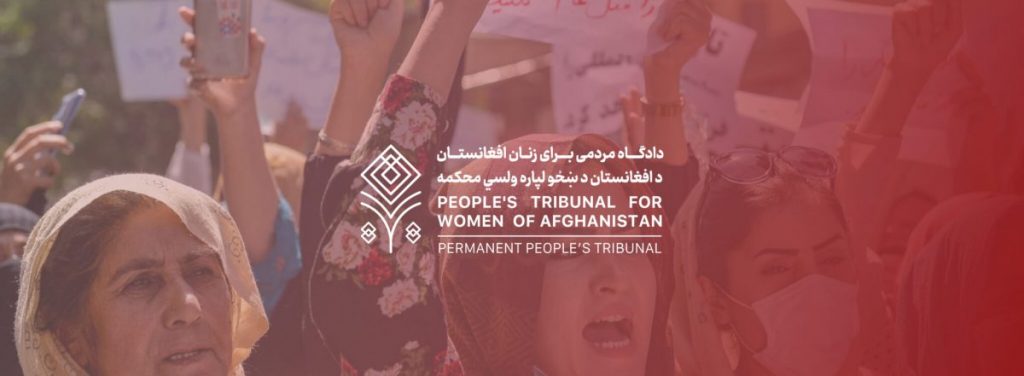
Du 8 au 10 octobre 2025, Madrid accueillera un événement d’une portée politique et morale considérable : le Tribunal populaire permanent pour les femmes d’Afghanistan. Organisé à l’initiative de quatre institutions de la société civile afghane en exil — Dread, l’Institut afghan des droits de l’homme et de la démocratie, Recherche et développement, et l’Association des défenseurs des droits de l’homme — ce procès citoyen vise à documenter et dénoncer les violations massives des droits des femmes afghanes sous le régime des Talibans.
Ce tribunal n’a pas de valeur judiciaire contraignante : il s’agit d’une instance informelle, héritière du Tribunal Russell de 1967, créé par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre pour juger symboliquement les crimes de guerre américains au Vietnam. Depuis, la Cour populaire permanente, fondée en Italie en 1976, a mené plus de cinquante procès de ce type sur des crimes internationaux restés impunis, du Timor oriental au Myanmar.
À Madrid, huit juges et quatre procureurs instruiront le dossier du « genre des Talibans », autrement dit la politique systématique de ségrégation, d’oppression et de violences exercées contre les femmes et les filles d’Afghanistan. L’objectif est multiple : dresser un tableau crédible de la situation, recueillir des preuves et des témoignages pour de futures actions devant les juridictions internationales, mais aussi faire pression sur les États et les organisations internationales afin qu’ils adoptent des mesures concrètes contre les Talibans.
Au-delà de son absence de pouvoir contraignant, la force du tribunal réside dans sa capacité à mobiliser l’opinion publique mondiale et à offrir aux femmes afghanes une tribune internationale. Comme par le passé avec d’autres procès symboliques, l’impact dépendra de la façon dont les défenseurs des droits humains et les médias sauront transformer le langage juridique en un discours accessible, porteur et mobilisateur.
Ce procès de Madrid se veut donc un acte de résistance morale et politique face à l’impuissance du système judiciaire international. Sa valeur repose sur la solidarité et la visibilité qu’il saura susciter autour d’une évidence : en Afghanistan, les Talibans mènent une guerre systématique contre les femmes.
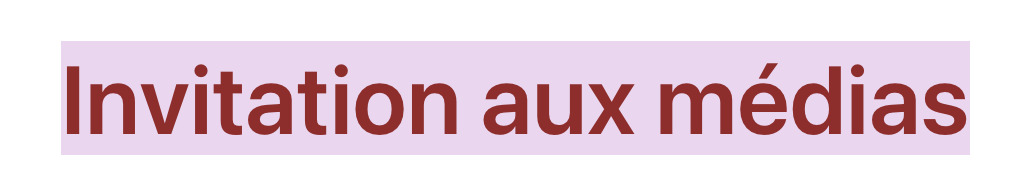
Le Tribunal populaire historique pour les femmes d’Afghanistan examinera la persécution sexiste comme un crime contre l’humanité.
MADRID, ESPAGNE – Une coalition d’organisations de la société civile afghane, sous les auspices du Tribunal permanent des peuples (TPP), invite les médias et les journalistes à assister aux audiences publiques du Tribunal populaire pour les femmes d’Afghanistan.
Cette initiative novatrice, centrée sur les victimes, entendra officiellement des témoignages et des preuves concernant l’oppression systémique des femmes et des filles par les talibans, qualifiant ces actes de crime international contre l’humanité de persécution sexiste. Les conclusions du Tribunal amplifieront la voix des survivantes, contribueront à la lutte contre l’impunité et appuieront les futurs efforts de responsabilisation au niveau international.
vous pouvez vous inscrire pour y assister en personne ou en live-stream

La lutte contre l’apartheid de genre
L’espoir par la responsabilité
Quatre ans après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, le pays disparaît du discours public en Europe et dans le monde. La responsabilité internationale est l’un des rares moyens de témoigner sa solidarité avec les femmes afghanes et de maintenir l’espoir d’un changement. Pour des millions de femmes et de filles afghanes dont les rêves et les ambitions ont été réduits à néant par les restrictions imposées par les talibans en matière d’éducation, d’emploi, de déplacement et d’accès à la justice , la responsabilité internationale reste une lueur d’espoir. Si des mesures existent pour traduire les talibans en justice devant la Cour pénale internationale (CPI), si une éventuelle affaire est envisagée devant la Cour internationale de justice (CIJ), et si une campagne de codification de l’apartheid de genre est menée, ces efforts doivent être renforcés pour impulser le changement et entretenir l’espoir.
L’année dernière, en septembre 2024, quatre pays – l’Allemagne, l’Australie, le Canada et les Pays-Bas – ont annoncé une initiative juridique visant à tenir les talibans responsables des violations de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Tout en saluant cette initiative importante, les groupes de défense des droits des femmes afghanes et la communauté des droits humains ont publiquement partagé leurs recommandations et préoccupations avec les États candidats. Ils ont appelé à des consultations constructives et sécurisées avec la communauté affectée, en Afghanistan et à l’étranger, à une participation inclusive, à la transparence et à la notification du processus, ainsi qu’à un large soutien par le biais d’actions de sensibilisation auprès des pays du Sud et des pays à majorité musulmane. Un an plus tard, les femmes afghanes et les défenseurs des droits humains attendent toujours des actions concrètes. Pendant ce temps, la répression des talibans contre les droits des femmes continue de s’aggraver, parallèlement à des signes inquiétants de normalisation des talibans dans la région et au-delà. Les expulsions d’Afghans par l’Allemagne et ses « contacts techniques » avec les talibans pour faciliter davantage d’expulsions sont en contradiction avec ses promesses de protection et l’esprit de cette initiative de solidarité avec les femmes et le peuple afghans.
Août 2025 marquait le quatrième anniversaire du retour illégal et violent des talibans au pouvoir en Afghanistan. Durant cette période, ils ont réussi à mettre en œuvre leur vision d’un régime religieux, autocratique et oppressif. Les talibans ont imposé des restrictions aux droits des femmes et des filles à l’éducation, à la circulation et à l’emploi. Les femmes sont bannies des médias, privées d’accès aux parcs, musées, restaurants, salles de sport et même aux espaces réservés aux femmes comme les salons de beauté. L’oppression des talibans s’étend aux filles et aux enfants : dès l’âge de 9 ans, elles sont punies pour leur tenue vestimentaire et se voient refuser l’entrée à l’école. Enhardis par l’absence de réponse internationale coordonnée, les talibans renforcent leurs restrictions par des lois répressives et s’attaquent aux rares exemptions existantes, comme celles qui concernent le travail du personnel féminin des Nations Unies . Lors de leur dernière attaque contre les droits des femmes et le droit international, les talibans ont refoulé le personnel féminin des Nations Unies des bureaux, entraînant la suspension des activités du HCR .
Les femmes afghanes qualifient depuis longtemps ce système d’« apartheid de genre ». Les politiques oppressives et discriminatoires des talibans à l’égard des femmes sont systématiques, institutionnalisées et font partie intégrante de leur système de gouvernance. Dans leur vision, toutes les femmes et les filles sont subordonnées aux hommes et aux garçons. Ils utilisent toutes les institutions à leur disposition – écoles, universités et médias – pour promouvoir cette vision. Fin 2024, les talibans avaient promulgué 130 décrets ciblant directement les femmes. En août 2024, ils ont introduit la loi sur la « promotion du vice et la prévention de la vertu » , codifiant l’exclusion des femmes de la vie publique.
Mon organisation, Rawadari , a documenté l’application croissante de la loi et son impact sur la société. Une jeune femme de ma famille élargie, Nargis (nom d’emprunt), a suivi une formation de sage-femme et a passé plusieurs années à travailler dans des régions reculées du sud de l’Afghanistan pour prodiguer des soins vitaux aux femmes et aux nouveau-nés. Lorsque les talibans ont pris le pouvoir, elle était effrayée et découragée, mais a décidé de rester et de poursuivre son travail. Comme les restrictions l’obligeaient à se couvrir davantage et à avoir un parent masculin vivant et voyageant avec elle, elle et sa famille ont continué à s’adapter pour qu’elle puisse exercer son travail essentiel. Parallèlement, elle poursuivait des études de médecine. Après l’adoption de la loi PVPV en août 2024 et la fermeture de la formation médicale pour les femmes en décembre 2024, sa patience et celle de sa famille ont fini par s’épuiser, et elle a déménagé au Pakistan début 2025. Seule, sans emploi et menacée d’expulsion, elle a perdu son emploi, sa communauté, sa protection juridique et sa patrie – et l’Afghanistan a perdu une sage-femme dévouée et expérimentée. Son histoire est l’une des milliers d’autres dévastatrices de cet apartheid de genre.
Les institutions talibanes, en particulier les services de renseignement et le ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice (MPVPV), ont recours à la détention illégale, aux disparitions forcées et à la torture pour punir ceux qui défient l’apartheid sexiste des talibans. Les talibans appliquent une censure stricte et suppriment l’espace civique et les médias indépendants . Grâce à la création de milliers de madrassas (écoles religieuses) récemment créées , ils cherchent à former une nouvelle armée de fidèles parmi les jeunes Afghans, femmes et hommes. Parallèlement, ils bénéficient d’une normalisation continue grâce à des avancées diplomatiques dans la région et au-delà, notamment la reconnaissance officielle de leur régime par la Russie en juillet 2025 .
Pour les femmes afghanes, l’avenir paraît sombre, tandis que le monde semble indifférent. Dans ce contexte dévastateur, l’action internationale n’est pas symbolique, mais essentielle : elle combat la culture de l’impunité, prévient de nouvelles violations et préserve l’espoir pour les femmes courageuses qui luttent pour leur dignité et leurs droits sous l’un des régimes les plus oppressifs au monde. Tous les efforts de responsabilisation doivent être renforcés afin d’empêcher la normalisation des talibans, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Afghanistan.
Alors que nous célébrons le premier anniversaire de l’initiative CEDAW, l’Allemagne doit honorer son engagement de demander des comptes à l’Afghanistan pour les violations de la CEDAW, éventuellement en saisissant la Cour internationale de Justice. Pour démontrer sa crédibilité, sa cohérence et son engagement envers le droit international, l’Allemagne doit mettre un terme aux expulsions vers l’Afghanistan et s’assurer un large soutien, notamment parmi les pays du Sud et les pays à majorité musulmane. La position de l’Allemagne dans l’ affaire Afrique du Sud c. Israël devant la CIJ a porté atteinte à sa crédibilité et affaibli les diverses alliances potentielles autour de l’initiative CEDAW. Une large alliance d’États soutenant l’initiative enverra un message plus fort aux talibans, généralement plus sensibles aux positions des États musulmans de la région. L’Allemagne doit désormais démontrer que cette initiative constitue un engagement sérieux en faveur des droits des femmes en Afghanistan, et non une simple déclaration symbolique ou un moyen de pression sur les talibans pour obtenir des expulsions.
L’initiative CEDAW est l’une des nombreuses voies actuelles vers la responsabilisation des violations des droits humains en Afghanistan et complète d’autres efforts importants. L’un d’eux est la campagne des femmes afghanes pour la codification de l’apartheid de genre . Amnesty International , Human Rights Watch et le Rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Afghanistan ont soutenu cet appel. Il est temps que l’Allemagne le soutienne également. Le projet de traité sur les crimes contre l’humanité est l’occasion de combler une lacune du droit international et ainsi de protéger les droits des femmes en reconnaissant l’apartheid de genre. L’Allemagne doit se tenir aux côtés des manifestantes, militantes et survivantes afghanes et soutenir leur inclusion.
En juillet 2025, la CPI a émis des mandats d’arrêt contre deux dirigeants talibans – une avancée rare vers la justice après des décennies d’impunité pour les crimes commis en Afghanistan. L’Allemagne et les autres États candidats doivent soutenir le mandat de la CPI en Afghanistan et au-delà afin de tenir les talibans responsables des persécutions sexistes et de dissuader les violations en cours. De plus, la communauté afghane des droits humains appelle à la mise en place d’un mécanisme international indépendant de responsabilisation pour l’Afghanistan, afin de favoriser la responsabilisation pour les crimes et violations commis dans le passé, ainsi que pour les crimes en cours. Ce mécanisme, dont on espère la mise en place lors de la session en cours du CDH, pourrait grandement contribuer à une éventuelle affaire devant la CIJ, ainsi qu’à l’enquête de la CPI et à la compétence universelle, en fournissant des documents et des preuves crédibles.
Les femmes afghanes et les défenseurs des droits humains ont mené une lutte acharnée pour obtenir justice et responsabilité. Outre son appel aux États membres, la société civile afghane a organisé le Tribunal populaire pour les femmes d’Afghanistan auprès du Tribunal populaire permanent. Cette initiative offrira aux femmes afghanes survivantes une « audience » et une nouvelle occasion de révéler le caractère systématique des persécutions sexistes perpétrées par les talibans, tout en visant à mobiliser davantage de solidarité et d’action en faveur des femmes afghanes. Lors des audiences qui se tiendront à Madrid, en Espagne, en octobre prochain, les procureurs afghans réitéreront leur appel à une approche tous azimuts en matière de responsabilité, notamment par des mesures concrètes concernant l’initiative de la CEDAW.




