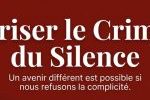Choisir la vie contre la peur* : l’extraordinaire résilience des Afghanes
par Elizabeth Cazaux

Il y a des images qui marquent plus que des slogans : une jeune femme courant au petit matin dans une rue de Kaboul, entièrement vêtue de noir, baskets aux pieds, masque sur le visage, défiant les regards et les interdits. On pourrait croire à une scène banale ailleurs, mais en Afghanistan, ce jogging en hijab relève de l’acte de résistance. Derrière cette apparente normalité se cache un choix vital : celui de la vie contre la peur. Chaque jour, des millions d’Afghanes, privées de droits par un régime qui les relègue à l’invisibilité, inventent des gestes pour rappeler qu’elles existent, qu’elles rêvent, qu’elles refusent la soumission.
Depuis août 2021, les talibans ont méthodiquement instauré ce que nombre de juristes et d’ONG qualifient désormais d’« apartheid de genre ». Plus de deux millions de filles ont été exclues de l’école secondaire, les universités leur sont interdites, les emplois bannis, les déplacements conditionnés à la présence d’un tuteur masculin. Mais à chaque interdiction correspond une réinvention. Là où un rideau s’abat, une fenêtre s’ouvre. Là où les portes des écoles se ferment, les salons, les caves, les toits et même les ondes radio se transforment en classes clandestines.
L’école interdite, les rêves tenaces
Un récent rapport de l’ONU a révélé que 92 % de la population afghane soutient le droit des filles à l’éducation. Autrement dit, malgré la propagande et la répression, la société afghane elle-même rejette l’obscurantisme imposé. Et les premières concernées, les filles, n’attendent pas qu’on leur rende leurs droits : elles inventent leurs propres chemins vers le savoir.
Dans les provinces reculées, des clés USB circulent discrètement, chargées de cours, de vidéos éducatives, de programmes scolaires complets. Dans les grandes villes, des applications mobiles permettent de suivre des leçons sans connexion Internet. Des professeurs exilés en Europe ou aux États-Unis enregistrent des cours qu’ils envoient via WhatsApp ou Telegram. La diaspora, loin d’oublier ses sœurs restées au pays, finance ordinateurs, imprimantes, voire des petites stations radios qui diffusent clandestinement des cours. L’UNICEF estime à près de 15 000 le nombre d’écoles informelles ou clandestines réservées aux filles.
Ces initiatives s’accompagnent d’exercices d’écriture, de concours, de programmes éducatifs innovants. Des jeunes filles racontent leur quotidien par des textes courts : la douleur de ne plus aller à l’école, mais aussi l’obstination à rêver. Certaines imaginent devenir pilotes, d’autres médecins, d’autres encore enseignantes. Ces récits bouleversants disent la même chose : on peut enfermer les corps, mais pas les esprits.
Les entrepreneures de l’ombre
Si l’éducation est le champ le plus visible de la résistance, l’économie devient un autre espace de survie et d’affirmation. Dans Kaboul ou Hérat, des femmes montent des ateliers de couture, des petites entreprises de safran, des apicultures, parfois même des studios photos. Beaucoup doivent se cacher, passer par des chaperons pour aller au marché, obtenir des autorisations en jonglant avec les règles. Mais elles persistent.
Certaines utilisent les réseaux sociaux comme vitrines vers le monde. Une jeune créatrice de sacs ornés de cristaux reçoit des commandes d’Europe et du Canada. Une autre relance la confection de robes traditionnelles, associant quatre ou cinq collaboratrices privées d’université. Chacune de ces initiatives prouve que le smartphone, l’Internet, l’ingéniosité et le courage sont plus forts que les diktats d’un régime.
Un programme audiovisuel, diffusé en toute discrétion sur des chaînes locales, documente ces parcours. Des caméras suivent des entrepreneures afghanes, décrivent leurs débuts, leurs obstacles et leurs réussites. Loin des réseaux sociaux mondialisés, ce « reality show » clandestin devient un acte politique : montrer que les femmes travaillent, créent, inventent, existent.
Diaspora et solidarité mondiale
Rien de tout cela ne serait possible sans la solidarité d’une diaspora active, inventive et profondément attachée à ses racines. Depuis la Suisse, une jeune réfugiée a lancé une plateforme d’apprentissage en ligne, mobilisant 70 professeurs bénévoles pour enseigner à 120 étudiantes en Afghanistan. Son rêve est d’atteindre 500 élèves. D’autres universitaires afghans exilés aux États-Unis ont créé une université en ligne offrant des cours de droit, de langues, mais aussi de métiers manuels permettant de gagner sa vie clandestinement.
Dans le Bangladesh voisin, une université accueille des centaines de jeunes femmes afghanes grâce à des bourses spéciales. En France, des associations discrètes continuent de transmettre cours et messages d’espoir. Même de petites initiatives individuelles – un professeur qui enregistre ses cours depuis son salon parisien, une association qui distribue des ordinateurs portables acheminés par des circuits informels – ont un impact immense.
Il y a là une leçon pour la communauté internationale : quand les grandes puissances reculent, quand les chancelleries parlent d’« affaires internes » ou d’« obstacles politiques », des citoyens ordinaires, des collectifs de femmes, des diasporas s’organisent pour sauver ce qui peut l’être.
Une créativité sans bornes
La résistance afghane ne se limite pas aux bancs improvisés d’une école clandestine ou aux machines à coudre d’un atelier. Elle se joue dans les gestes du quotidien, qui deviennent subversifs.

Courir dans la rue en hijab et baskets. Danser du breakdance sur les toits de Kaboul. Maintenir des salons de beauté cachés malgré les rafles et les menaces. Ces actes pourraient sembler dérisoires, mais dans un pays où les talibans traquent la moindre expression féminine, ils deviennent des cris de liberté. Lorsque, le 30 août dernier, les autorités ont décrété la fermeture des salons clandestins, beaucoup ont souri amèrement : ce n’était pas la première interdiction, et ce ne serait pas la dernière. « Rien ne nous soumettra », disent les femmes. Et l’histoire afghane prouve qu’elles trouvent toujours un passage, un recoin, une échappée.
L’éducation comme ligne rouge
La communauté internationale, pourtant, semble se fatiguer. Les négociations de Doha en 2023 l’ont montré : les talibans ont accepté de rencontrer l’ONU et une vingtaine de pays, mais seulement à condition que les femmes soient exclues des discussions. Et beaucoup de diplomates ont cédé. Les droits humains, au lieu d’être un objectif, sont devenus un « obstacle » aux yeux de plusieurs États.
C’est pourquoi des ONG appellent à reconnaître l’« apartheid de genre » comme crime contre l’humanité. Une telle codification dans le droit international permettrait de tracer une ligne rouge : l’éducation des filles ne peut pas être négociée, marchandée ou différée. Elle doit être garantie, quoi qu’il en coûte. Car priver la moitié d’un peuple de savoir, c’est condamner tout un pays à l’obscurité.
Les Afghanes comme modèle universel
Ce qui frappe, au-delà des chiffres et des rapports, c’est la dignité. Ces jeunes filles qui écrivent qu’elles sont « des oiseaux privés de ciel », ces femmes qui reprennent leur souffle en travaillant à l’ombre, ces étudiantes qui connectent leur téléphone à un cours WhatsApp malgré les coupures d’électricité : elles ne se perçoivent pas comme des victimes passives, mais comme des combattantes.
Elles ne nient pas la peur – peur d’être arrêtées, battues, humiliées. Mais elles refusent qu’elle dicte leur vie. En choisissant de rêver, d’apprendre, de créer, elles donnent une leçon universelle : la liberté n’est jamais totalement perdue tant que l’esprit continue de s’y accrocher.
Une responsabilité partagée
Devant cette énergie, la question est simple : que fait le reste du monde ? Les sanctions, les résolutions, les protestations diplomatiques sont importantes, mais elles restent insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas d’un soutien concret aux initiatives de terrain. Les Afghanes n’attendent pas qu’on vienne les « sauver » : elles sauvent déjà leur avenir, chaque jour, par leur intelligence et leur courage. Ce qu’elles demandent, c’est un appui : des financements pour les écoles clandestines, des bourses pour les étudiantes exilées, une reconnaissance juridique internationale de leur oppression.
L’histoire retiendra moins les communiqués que les gestes. Ce sont les ordinateurs envoyés discrètement, les clés USB passées de main en main, les vidéos éducatives enregistrées dans une chambre d’exilée qui, demain, nourriront la renaissance d’un Afghanistan libre.
Choisir la vie
« Après la nourriture, le plus important pour un être humain est d’avoir de l’espoir », dit une jeune professeure réfugiée en Europe. Cet espoir, les Afghanes le maintiennent vivant. Elles choisissent la vie contre la peur, et ce choix est peut-être leur plus grand acte de résistance.
À l’heure où les talibans croient pouvoir réduire la moitié de la population au silence, ces femmes montrent que le silence est impossible. Elles courent, écrivent, cousent, enseignent, dansent. Elles transforment chaque geste en affirmation d’existence.
Le monde a devant lui une responsabilité immense : écouter, soutenir, amplifier ces voix. Car elles ne sont pas seulement l’avenir de l’Afghanistan. Elles sont la preuve éclatante que, même sous la tyrannie, l’être humain garde toujours la possibilité de choisir la vie contre la peur.
* selon l’expression de Carol Mann
À lire aussi