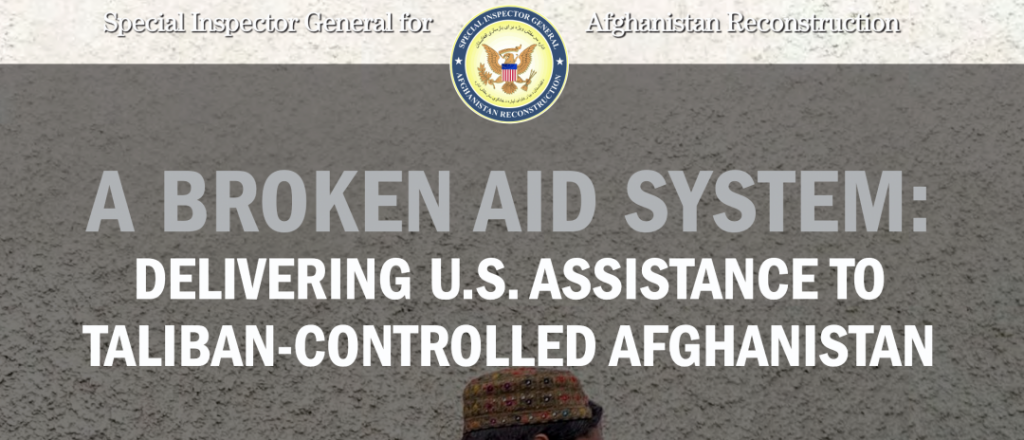
Résumé analytique du rapport SIGAR-25-29-LL
SIGAR-25-29-LL
SIGAR-25-29-LL-1FR en français
Contexte et objet du rapport
Ce rapport du Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), daté de juillet 2025, examine l’évolution de la situation en Afghanistan quatre ans après le retrait des forces américaines et l’effondrement du gouvernement républicain. L’objectif est d’évaluer les conséquences politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires du retour au pouvoir des Talibans, en s’appuyant sur des observations de terrain, des données d’agences internationales, ainsi que sur des témoignages recueillis auprès d’Afghans et de responsables étrangers. Le document analyse également la manière dont l’aide internationale est gérée, les stratégies des Talibans vis-à-vis de la communauté internationale, et l’impact de leur gouvernance sur la stabilité régionale et mondiale.
1. Prise de pouvoir des Talibans et consolidation autoritaire
Depuis leur entrée à Kaboul en août 2021, les Talibans ont établi un régime politique fondé sur l’autorité absolue du Guide suprême, Haibatullah Akhundzada, et d’un cercle restreint de chefs religieux et militaires. Le système de décision repose sur des décrets émis depuis Kandahar, sans processus législatif ni consultation publique. Les ministères sont sous contrôle de fidèles du mouvement, souvent dépourvus de qualifications administratives. Cette centralisation extrême s’accompagne d’une purge systématique des anciens fonctionnaires, y compris au sein de la police, de l’armée et de l’appareil judiciaire.
La gouvernance est marquée par une application stricte de l’idéologie talibane : suppression des droits politiques, élimination de la participation féminine dans la vie publique, contrôle idéologique de l’éducation et restriction sévère de la liberté d’expression. Les Talibans refusent toujours de former un gouvernement inclusif, malgré les appels internationaux.
2. Dégradation sécuritaire et sanctuarisation du terrorisme
Le rapport souligne que, contrairement aux assurances données par les Talibans à Doha en 2020, l’Afghanistan est redevenu un refuge actif pour des groupes terroristes transnationaux. Al-Qaïda maintient des bases d’entraînement dans plusieurs provinces, avec un noyau de commandement protégé par le régime. Le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) mène des opérations depuis le territoire afghan, contribuant à l’escalade des violences au Pakistan. Des groupes affiliés à l’État islamique (EI-K) poursuivent leurs attaques, souvent dirigées contre des minorités religieuses comme les Hazaras.
Les Talibans instrumentalisent la présence de l’EI-K pour se présenter comme un partenaire sécuritaire potentiel auprès de certains pays, mais le SIGAR note qu’ils n’ont pas entrepris d’efforts soutenus pour éradiquer cette menace. Le rapport met en garde contre le risque d’une projection accrue de ces groupes vers l’Asie centrale, le Moyen-Orient et au-delà.
3. Économie en crise et corruption endémique
L’économie afghane s’est contractée de plus de 25 % depuis 2021, avec un PIB fortement dépendant de l’aide humanitaire et de quelques exportations comme le charbon, les pierres précieuses et les produits agricoles. Le retrait massif des financements étrangers et la perte de l’accès aux réserves monétaires internationales ont accentué la pauvreté : plus de 90 % de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté.
Le SIGAR décrit un système de corruption institutionnalisée : détournement de fonds humanitaires, taxation illégale des ONG, prélèvements arbitraires sur les commerçants, et profits tirés du trafic de drogue et de méthamphétamine. Les revenus publics sont captés par les réseaux proches du Guide suprême et investis dans l’appareil sécuritaire, plutôt que dans des services publics.
4. Effondrement des droits des femmes et apartheid de genre
Le rapport insiste sur la gravité de la situation des femmes, qualifiée de « l’un des pires reculs des droits humains dans le monde ». Depuis 2021, les Talibans ont fermé l’accès des filles à l’éducation secondaire et universitaire, interdit aux femmes de travailler dans la plupart des secteurs, et imposé des restrictions extrêmes à leur mobilité. Les femmes sont également exclues des soins médicaux spécialisés en raison des interdictions pesant sur les médecins et infirmières de sexe féminin dans plusieurs provinces.
Le SIGAR utilise explicitement l’expression « apartheid de genre », soulignant que ces politiques ne sont pas temporaires mais constituent un projet politique structuré.
5. Manipulation et contrôle de l’aide internationale
Bien que l’Afghanistan soit aujourd’hui l’un des pays les plus dépendants de l’aide humanitaire, les Talibans en ont pris le contrôle indirect : exigences de partage de données, taxation des programmes, choix des bénéficiaires selon des critères politiques ou tribaux. Le rapport documente plusieurs cas où des ONG ont dû renoncer à employer des femmes ou modifier leurs projets pour éviter les représailles.
Le SIGAR avertit que cette instrumentalisation de l’aide permet aux Talibans de renforcer leur légitimité locale et leur appareil administratif, tout en réduisant l’impact sur les populations les plus vulnérables.
6. Isolement international relatif et soutien discret de certains États
Si la plupart des pays occidentaux refusent toute reconnaissance officielle, certains États – notamment la Russie, la Chine, l’Iran et le Qatar – ont intensifié leurs échanges avec le régime taliban, que ce soit pour des raisons sécuritaires, économiques ou géopolitiques. Des accords commerciaux et des projets d’infrastructure sont en cours, offrant aux Talibans des alternatives partielles au soutien occidental.
La Russie envisage ouvertement la reconnaissance, ce qui pourrait briser le consensus international issu des résolutions du Conseil de sécurité. Le SIGAR estime qu’un tel scénario renforcerait l’impunité des Talibans et compliquerait les efforts de lutte contre le terrorisme.
7. Conséquences humanitaires et sociales
La combinaison de la pauvreté, de la répression et du délitement des services publics a créé une crise humanitaire chronique : malnutrition infantile, effondrement du système de santé, déplacements forcés dus aux conflits internes et aux catastrophes naturelles. Les minorités ethniques et religieuses subissent des discriminations systématiques, allant jusqu’à des violences ciblées.
La jeunesse, privée d’éducation de qualité et exposée à un discours religieux radicalisé, est particulièrement vulnérable au recrutement par les groupes armés.
8. Recommandations du SIGAR
Le rapport conclut par une série de recommandations :
-
Maintenir et renforcer les sanctions ciblées contre les dirigeants talibans, en particulier dans le cadre du régime onusien visant Al-Qaïda et ses affiliés.
-
Conditionner toute aide au respect de critères mesurables en matière de droits humains, en particulier pour les femmes et les minorités.
-
Soutenir les médias indépendants et les réseaux de la société civile afghane, y compris en exil.
-
Intensifier la coordination régionale pour contenir la menace terroriste émanant de l’Afghanistan.
-
Développer des mécanismes de distribution humanitaire qui contournent les canaux contrôlés par les Talibans.
Analyse finale
Le SIGAR dresse le portrait d’un Afghanistan verrouillé politiquement, en crise économique profonde, et redevenu un acteur central du terrorisme transnational. L’échec des engagements pris à Doha, la répression systématique des femmes, la corruption institutionnalisée et la manipulation de l’aide humanitaire sont autant d’éléments qui rendent improbable toute amélioration sans pression internationale accrue. Le rapport met en garde contre le risque d’une normalisation du régime taliban sur la scène internationale, qui équivaudrait à accepter la consolidation d’un État autoritaire fondé sur la violence, l’exclusion et l’exportation de l’instabilité.




